Possibles, revue, parcours... n°35, 34, 33, 32...
10/06/2025
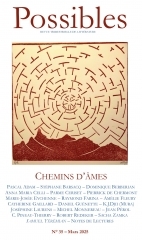 J’ai parcouru d’un même élan ces quatre numéros de la revue Possibles. Sans volonté de lecture exhaustive. L’avantage d’un tel parcours c’est qu’il laisse se faire des choix d’évidence.
J’ai parcouru d’un même élan ces quatre numéros de la revue Possibles. Sans volonté de lecture exhaustive. L’avantage d’un tel parcours c’est qu’il laisse se faire des choix d’évidence.
Possibles n°35, Chemins d’âmes
(Illustration de couverture de K.J.Djii/JF Mura)
Ce n’est pas un volume à thème. Pierre Perrin a choisi ce titre en évoquant Dante et Emmanuel Godo, dont le livre, Ton âme est un chemin, Artège, 2024, inspire trois textes. Ils précèdent les notes de lecture, à la fin du volume. Mais l’exergue, une citation d’Emmanuel Godo (deux phrases du livre) m’a menée vers ce dossier… « Méditation sur Dante d’Emmanuel Godo », par Stéphane Barsacq, qui montre que ce livre « écrit sur près d’une décennie » est une sorte d’initiation à l’œuvre de Dante, à la signification essentielle du message de Dante, « l’éternité » pensée selon le destin de « l’âme ». Il voit dans l’œuvre de Dante un « miroir », qui « nous permet du plus loin du temps, du plus loin de la nuit, de nous regarder en face dans la plus grande proximité et la plus grande distance ».
Puis « De Dante à Godo, le miracle de Jéricho », par Robert Redeker. Il définit l’ouvrage comme « un livre de poète, qui lui-même s’enfonce dans celui d’un autre poète, Dante », œuvre qui met en lumière « la vie spirituelle et l’âme », refoulés de notre modernité, et fait penser « l’homme comme être porté par une destinée ». Par ce livre, écrit Robert Redeker, le lecteur « redécouvre, par une anamnèse à la façon de Platon, que son âme, c’est-à-dire sa vie intérieure, est un chemin, et que chaque homme est une destinée ». Il définit aussi la poésie, en analysant ce que Godo peut faire, en poète, car en voyant (comme le dit Rimbaud). Voyant au-delà de la vue humaine (d’où cette mention du miracle de Jéricho, ce qui rend la vue). La poésie authentique est ce qui fait cela, menant l’âme vers sa destinée, le reste n’étant que littérature. Autre lecture, autre démarche, « Dialogue à trois voix », par Pierrick de Chermont, qui suit les temps du livre, en inscrivant des notes sur les questionnements et réflexions inspirés à Emmanuel Godo par le parcours de Dante, qu’il fait sien dans un dialogue entre un père et sa fille (deux voix, la troisième étant celle de Dante, mais on peut comprendre aussi Dante, Godo, et le lecteur). « L’Enfer », partie qui traite de la question du mal, donc de la morale, de ce qui est juste. Citation du livre de Godo, celle qui est retenue par Pierre Perrin en exergue de la revue : « La vraie vie, ce n’est pas la littérature. Ce n’est pas ce qui est écrit qui compte, mais la justice qu’on crée en soi et hors de soi. » Pierrick de Chermont éclaire ce qu’il voit dans le « triptyque de la Comédie », être « le propre de l ‘homme » : « Un », « un désir singuier » ; « deux », « liberté innée » ; « trois », « ce désir singulier est de co-naître ». Autre lieu, ou étape du livre, « Le Purgatoire », analysé là comme « une question terrienne, pas seulement spirituelle », « le lieu géographique de l’apprentissage de l’autonomie individuelle qui est la visée du long cheminement de la Comédie ». Quels liens interrogent l’humain ? Il note ceux des vivants et des morts, et « liens entre le politique et sa vie intérieure », pour Dante, et pour tout humain. Et « Le Paradis », ou la lumière. Que Pierrick de Chermont voit « comme un tourbillon de lumière dans un océan de noir ».
Pas étonnant que ces trois auteurs aient mené cette triple étude. Je dis cela pour avoir consulté la notice mentionnant certaines de leurs publications. De Stéphane Barsacq, je note un titre, Mystica, Éditions de Corlevour, 2018. De Robert Redeker, L’Abolition de l’âme, Cerf, 2023. Et de Pierrick de Chermont, Par-dessus l’épaule de Blaise Pascal, Corlevour, 2015, Les Limbes, Corlevour, 2022... Pages passionnantes. Ouverture de perspectives : relecture de Dante, lecture d’Emmanuel Godo, découverte des titres des trois auteurs-lecteurs de Godo-Dante... On est à hauteur d’exigence. Échos, dans le Possibles n°32, un poème d’Emmanuel Godo, « Jaccottet dans le RER B », et une recension de Pierre Perrin.
Lecture de textes, suite du numéro 35. J’ai d’abord lu les poèmes de Raymond Farina, sa volonté de se penser nomade, (« Passion nomade »), rejetant la nostalgie des « ciels d’enfance », la pensée profonde venue de « l’or infini d’un désert ». Lumière que cet or, son « sable » et en lui « chaque pierre embrasée ». Une matérialité qui nourrit la vision qui fait se rencontrer en soi des mémoires passées, les interroger, sachant le « lexique trilingue » enfui dans un temps perdu, avec un jardin, ses roses, et ses chants d’oiseaux, comme une image de réalité (« Attente de l’exilé »). Le passé c’est aussi le père, et l’exil du père, héritage qui redouble le sien (« Le père de marbre »). Est-ce un tel vécu qui crée cette lucidité des déchirements intérieurs sus (« Contradictions ») ? Reconnue, « Cette discorde en nous du clair et de l’obscur », mais vers « notre humanité », « ascendance à venir dont nous naîtrons peut-être ». Pas de lieu, réel ou mental, sans oiseaux dans l’univers de Raymond Farina (« Le legs de l’hirondelle »). Vivants ou morts ils enseignent, le faisant hériter d’un « legs immatériel ». Dans le présent c’est l’évocation des « femmes d’Iran et du Turkestan » (poème « Dévoilement »), espoir solidaire. Pour le regard c’est Van Gogh, ses « bleus » pour « saisir l’Infini », Vincent, sa détresse, sa folie.
La notice sur Raymond Farina liste quelques titres et rappelle le volume des Éditions des Vanneaux, L’Oiseleur des signes, essai et anthologie par Sabine Dewulf. Son dernier recueil, Les Grands Jaseurs de Bohême suivi de L’Oiseau de Paradigme, N&B Éditions, 2024, est recensé dans ce numéro par Joëlle Pétillot, voir plus bas.
Suite de mon parcours... Les poèmes de Daniel Guénette. Que ce soient les textes extraits du recueil Varia (2018) ou de La fatigue de la haine (2024) je retrouve une thématique liée à la question de la mort. « Tu entends sur le bois / Tomber déjà les pelletées », la pensée des « traces qui s’effacent » et du nom « qui ne dit plus rien à personne ». Et encore les « pelletées de terre ». Conscience de notre disparition programmée, et mesure de tout ce que cela signifie d’effacement. Parme Ceriset, elle, chante au contraire cette « offrande » qu’est le visage de l’autre, aimé, et le sentiment que peu importe la fin si c’est « en ayant accompli / sa part de rêve ». Intriguée par le pseudo d’écriture de Jean-François Mura, K.J.Djii, heureusement expliqué, K comme initiale d’un mot allemand à traduire par résonances ou correspondances, le tout signifiant les grandes résonances de JF M. Expression d’une ambition, qui est de traiter de sujets vastes (au sens spirituel du terme) dans des poèmes dont l’ensemble est comme une métaphore centrale, inventer un récit mythique (« Poèmes des Eaux-Delà »), pour penser « notre voie au travers des marches de l’espace et du temps », « à la poursuite de nouveaux continents du possible ». Toujours en accord avec le titre de ce volume 35, on lit, dans les pages de Christophe Pineau-Thierry, la possibilité de « se rendre au chevet de l’âme » et l’évocation de « cette part ignorée de nous, notre part d’invisible », puis c’est un dialogue sur le silence...
Recensions. Les Grands Jaseurs de Bohême, suivi de L’Oiseau de paradigme, de Raymond Farina, N&B Éditions, 2024, lu par Joëlle Pétillot. Elle a noté « l’art de l’image en deux mots », l’écriture en octosyllabes, et pas ou peu de rimes. Mais elle mentionne aussi « l’humour », « l’autodérision ». Pour conclure par cette formule : « un livre de sagesse ». Pierre Perrin a rédigé plusieurs notes de lecture, dont celle du roman de Philippe Brandes, En ce qui concerne Alexandre, Accro Éditions, 2022, où il voit un chef-d’œuvre. Pour avoir trouvé, dans les sept parties du livre, une profondeur dans l’analyse des motivations des actes des personnages, et du principal, pour y découvrir « sur l’âme humaine, des vues singulières », et une riche réflexion sur le mal, d’une part, l’identité, d’autre part.
................................................
Possibles n°34, dossier Jean-François Mathé
Études, hommage, et courriels adressés à Pierre Perrin. Notes sur l’écriture, mention de lectures, critiques parfois grinçantes. Et sur deux chroniques le concernant, qui l’avaient choqué, blessé, sont publiées ses réponses. L’une le mentionne par un seul texte, et généralise un bilan négatif, sans lien avec quoi que ce soit d’autre de ses écrits, procédé assez choquant, oui. L’autre est une critique stérilement cruelle, et apparemment fondée sur des erreurs de lecture. On se demande ce qui motive les auteurs de chroniques de ce genre. Peut-être la conviction d’un droit de jugement, affaire d’ego. Je n’aime pas la critique de démolition des œuvres ou des êtres (mais c’est toujours un peu des êtres). On n’aime pas, donc on n’en parle pas, sauf discussion critique d’idées (cela tient au débat). En 4ème de couverture Pierre Perrin dit l’amitié qui le liait à cet auteur, et l’importance que peuvent avoir des correspondances.
Recensions. Les Chemins dérisoires, de Jean-Claude Tardif, Petra, 2024, par Pierrick de Chermont, qui insiste sur l’amitié, inscrite dans la dédicace et le choix de l’exergue. Cela et le pays, la région, parcourue par l’auteur. Le Complexe d’Orphée, Essai sur l’objet « poésie », de Daniel Guénette, Nota bene, 2023, par Pierre Perrin, qui en fait l’éloge (« nécessaire, fort et beau »). La Nuit des sources, de Jacques Robinet, La Coopérative, 2024. Livre sous-titré « Notes des années 2021-2023 ». Pierre Perrin rapproche sa prose de celle de Pierre-Albert Jourdan, et mentionne la pensée de la mort présente dans les écrits de celui qui s’y préparait, la sachant imminente, et les réflexions sur l’humain de celui qui fut prêtre quelques années, avant de devenir psychanalyste.
...............................................
Possibles n°33, Carnets II.
Je commence par l’exergue, Flaubert. Un extrait de sa lettre à Louise Colet du 23 décembre 1853, Correspondance, La Pléiade, tome II, p. 485. Question sur « ce qu’il faut » [...] « pour constituer une grandeur d’âme » [...] « pour écrire une bonne page », au-delà des « chagrins » et « supplices » vécus. Éternelle double (ou plutôt triple) question. D’abord, comment malgré des épreuves et dégoûts divers ne pas se laisser rabaisser par ce qui pollue la conscience et au contraire choisir ce qui grandit, permet peut-être une sorte de détachement... ? Et comment, malgré ces difficultés intérieures qui obstruent l’accès à une certaine hauteur d’être, réussir à créer de la qualité dans l’écriture ? Le troisième élément de la question porte sur ce lien entre la qualité spirituelle (pas au sens religieux) et la démarche d’écriture. Et d’où vient ce qui fait advenir l’écriture ? Le choix de cet exergue est motivé par les pages qui suivent. Marie-Paule Farina (qui a publié un essai sur Flaubert en 2020, aux éditions L’Harmattan) a choisi des extraits de lettres de Flaubert qu’elle a introduites par un texte où elle insiste sur « l’écriture travaillée et retravaillée » des romans de Flaubert, et, dans ses lettres, une « magnifique extravagance ».
Feuilletant le volume je lis avec attention les pages de Frédéric Tison (décédé en novembre 2023, à 51 ans), titrées « Minuscules ». Ce sont des extraits de ses carnets (2008-2018). Des fragments, une page au plus, parfois une ligne ou deux. Des douleurs ont pu être la source de certains textes, mais on sent que, plus encore, il y a cependant une force vitale lumineuse qui fait surgir les phrases. On découvre des réflexions qui ne sont pas que traces de l’instant, et des bribes qui sont des éclats. Importance du regard, évoqué encore et encore, et, synthèse, « Le poème et le regard peuvent être des synonymes ». Mais aussi la poésie, pensée comme « un immense "Il était une fois" », donc aussi comme mémoire transfigurée des histoires vécues de ceux qui écrivent : « "Il était une fois ce qui est arrivé" – "Il était une fois ce qui m’est arrivé" – et je chante. ». Citant Pindare (« L’homme est le rêve d’une ombre », Pythiques, VIII), il poursuit la métaphore vers ce risque permanent pour l’humain « d’être le rêve d’une ombre effacée ». Et, tristement, d’être des ombres « qui se croisent, toujours plus nombreuses et cependant séparées ». Alors, le poème ? Il est « un langage qui veille au sein des langues ». Et « Le temps du poème » est « un temps bouleversé ». Une notice de Norbert Crochet (qui a établi le choix des fragments), explique la méthode d’écriture de Frédéric Tison, « en trois temps ». Notes sur des carnets, puis reprise et développement des fragments dans des cahiers, et enfin, après un temps de maturation, choix d’extraits, « aphorismes et réflexions », ses « Minuscules », alors autoédités avec des photographies sur le site Blurb. Carnets précédents détruits. Pages suivantes, Claire Boitel, qui le connaît bien (et a écrit un essai sur lui, La voix derrière la voix, Petra, 2023), présente Frédéric Tison, « un homme mystérieux », dans un beau texte ciselé, à travers le deuil et les souvenirs d’un être qui « traversait pensées et mots avec la profondeur légère d’une intelligence suprême confrontée à la douleur », qui a « dans ses poèmes soulevé la beauté jusqu’au feu », et « transformé sa larme en nuage ». De Frédéric Tison, « un être hors normes », elle se souvient de l’« aura », d’une « grâce ». Son écriture, pour parler de lui, rejoint une même densité.
Puis j’ai lu certaines recensions. Comme Leçons de l’arbre et du vent, de Jacques Réda, Gallimard, 2023, par Pierre Perrin. Qui note que l’auteur « prend ses distances avec la modernité » (alexandrin, majuscules en début de vers, ponctuation...). De Geneviève Catta, La Minute passe sur les épaules de ta voix, Pierre Turcotte, 2022, par Carmen Pennarun. J’apprécie qu’elle signale les exergues des cinq chants, des citations de François Cheng tirées de Cinq méditations sur la beauté. Lectrice de Cheng, voilà un signe fort. D’Isabelle Lévesque et Sabine Dewulf, Magie renversée, avec les peintures de Caroline François-Rubino, Les Lieux-Dits, 2024, par Alain Nouvel. Livre, superbe, que j’ai lu et relu, dont j’ai publié une recension....
...............................................
J’ai recherché, dans le Possibles n°32, le poème d’Emmanuel Godo, « Jaccottet dans le RER B ». Ce qui m’apparaît, c’est la lucidité du propos, et la profondeur de notations sur les limites de la présence (« ce malheur » partagé « de ne pas vivre ensemble »). Et j’ai lu la recension de son recueil, Les Égarées de Noël, Gallimard, 2023, par Pierre Perrin. Qui dit de ce livre « Un mystère le porte. C’est celui qui conjoint l’indicible à la simplicité », pour conclure ainsi : « un livre de lumière ».
SITE, Possibles : http://possibles3.free.fr/
Recension Marie-Claude San Juan

1 commentaire
Quel admirable travail, chère Marie Claude,
Bien sûr je reporte vos notes dans les retours afférents à chaque numéros lus. Et je ne manquerai pas de signaler leur source, vos belles Traces nomades (en indiquant le lien où vous relire. Un grand merci encore. Bon été à vous,
Les commentaires sont fermés.