Poésie de Raymond Farina : Les Grands Jaseurs de Bohême, suivi de L'Oiseau de paradigme
01/08/2025
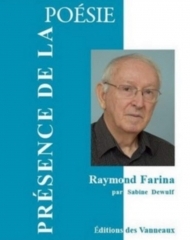 Le poète Raymond Farina est l’auteur de nombreux recueils, dont, au début, plusieurs publiés par les éditions Rougerie, autres éditions pour les plus récents. À son art il faut ajouter la traduction (pour plusieurs langues). Né en Algérie il évoque dans certains textes des mémoires associées aux vécus présents, souvenirs concrets de choses perçues dans l’enfance, la beauté du vivant et de la nature, même celle qui entre en effraction dans les villes, et bien sûr la présence des oiseaux, qui font partie de son univers à l’égal de la poésie des livres. De formation philosophique il a enseigné cette démarche vers la sagesse qu’est la philosophie authentique. Transmettre, il le poursuit, en traduisant et en donnant à lire des textes qu’il aime. Après avoir enseigné dans divers pays il vit entre La Réunion et la Bretagne.
Le poète Raymond Farina est l’auteur de nombreux recueils, dont, au début, plusieurs publiés par les éditions Rougerie, autres éditions pour les plus récents. À son art il faut ajouter la traduction (pour plusieurs langues). Né en Algérie il évoque dans certains textes des mémoires associées aux vécus présents, souvenirs concrets de choses perçues dans l’enfance, la beauté du vivant et de la nature, même celle qui entre en effraction dans les villes, et bien sûr la présence des oiseaux, qui font partie de son univers à l’égal de la poésie des livres. De formation philosophique il a enseigné cette démarche vers la sagesse qu’est la philosophie authentique. Transmettre, il le poursuit, en traduisant et en donnant à lire des textes qu’il aime. Après avoir enseigné dans divers pays il vit entre La Réunion et la Bretagne.
.............
 Les Grands Jaseurs de Bohême, suivi de L’Oiseau de paradigme, N&B Éditions (coll. Poésie), 2024.
Les Grands Jaseurs de Bohême, suivi de L’Oiseau de paradigme, N&B Éditions (coll. Poésie), 2024.
Les oiseaux, évidemment. Mais même quand ils ne sont pas dans les titres ils sont dans les livres de Raymond Farina. Là c’est affirmé dès le premier poème : savoir être attentif au chuchotement ou au chant des oiseaux est pour lui une mesure de l’humain. Ainsi « ces petits riens volants » (dont il est dit en note que c’est une expression de Pierre Belon, dans son Histoire de la nature des oyseaux) peuvent être un test, comme la « Fable de Düss » utilisée pour les enfants. On voit que non seulement il écrit sur ces petits êtres et sur le rapport au vivant fragile que la perception qu’on en a trahit, mais aussi il lit sur eux. Cependant, écrit-il, ce n’est pas dans les livres qu’il a puisé sa science des oiseaux, « mais sur les chardons et les branches ».
Ce serait se tromper gravement que prendre cette passion pour les oiseaux pour une fuite vers le rêve, ou le goût léger du joli. Dès les premiers poèmes le sens est donné, qui ne manque pas de gravité. Si la fable du début fait du poème une interrogation test, c’est pour affirmer que l’oiseau signifie. Et révèle. En quelques vers (p. 11) deux dimensions de la pensée sont indiquées. La réflexion métaphysique : notre réalité éphémère sur notre planète perdue dans l’espace. Et nos fonctionnements suicidaires : « notre espèce qui s’entête / frivolement à se détruire », entraînant dans la mort aussi les oiseaux, « désolés d’être, grâce à nous, / ceux qui vont bientôt disparaître ». Et toujours il y a la mémoire fondatrice des oiseaux de l’enfance en Algérie, car c’est là qu’est née cette sagesse. Le regard sur l’univers de l’oiseau était alors ancré dans son « innocence » et ce qui était « en ce temps, un royaume / aussi bleu que le myosotis ». Mais il y avait déjà un objectif en « lucidité » cherchée : « traverser la nuit du monde ».
Ce qui fait naître cette poésie vient de questionnements d’ordre philosophique et d’une inquiétude existentielle, lucide, oui, mais sans désespoir. D’ailleurs le livre est dédié à ses enfants, le premier recueil (des Grands Jaseurs de Bohême...) à sa fille, et L’Oiseau de paradigme à son fils. Car le but est de transmettre la beauté, pas la négativité. Dans la conscience du paradoxe de ce réel où vivre entre nuit et... bleu. Si l’oiseau lui a enseigné, dit-il, la « douceur », celle de ses plumes, douces comme « la peau ou le pétale », ce n’est pas pour occulter quoi que ce soit. C’est pour ne pas s’enfermer dans les ombres du monde, la douceur étant l’équivalent de la tendresse, réparatrice des douleurs, par un geste intérieur plus juste que le piège de « l’illusion de découvrir / tout ce qui souffre au fond des choses // ce qui discrètement s’éteint / dans chacune de leurs secondes ».
On est dans l’univers d’une sagesse loin de toute arrogance de pensée, la douceur devenant le signe d’une démarche qui induit des choix sémantiques écartant la dureté et privilégiant des sonorités (assonances ou allitérations) respectant l’univers sonore des oiseaux, la phrase coulant parfois longuement sur plusieurs vers, comme un chant murmuré, jamais heurté. Les mots esquissent : « sucs subtils », « ciels », « soie » : une caresse pour des « jaseurs » qui « ne jasent plus ». Et tant pis si un des chants entendus est « discordance sonore » : il prête sa note d’humour, et on sourit encore, comme en d’autres pages. Image étonnante que celle des « voyous volants » [...] « qui, sur les fils télégraphiques, / volent secrets et confidences ». Spectacle qu’on connaît, points sombres posés sur ces fils comme des lettres ou notes de musique. Mais qui dans le poème fait de ces petits êtres des prédateurs des pensées (après les « razzias » de fruits...). On est entre petite note plaisante, jeu, et bascule presque fantastique, ou animiste (si on pense l’animal riche d’une conscience pas si étrangère à la nôtre...).
L’Algérie n’est jamais loin. Évocation du sirocco, quand « L’espace devenait l’empire / du sec, des serpents et des pierres », et apparition du rapace appelé serpentaire, qui n’appartient qu’à l’Afrique (du Nord aussi), cet ennemi des serpents et des scorpions... Plaisir des noms divers qui le désignent. Mais les mots traversent les vérités taxinomiques ou taxonomiques pour glisser vers le symbolique, et, presque, encore, une approche animiste. Ce qui est logique : l’imprégnation algérienne de l’univers animiste a atteint tous les inconscients des méditerranéens dont les ancêtres avaient déjà été nourris, ailleurs, conception ancestrale passant le filtre des religions diverses et des systèmes de pensée. Cela se traduit en signes. Le serpent avalé par le serpentaire est pour le rapace « symbole d’une Éternité », capturée ainsi aux yeux culturels de l’humain, du poète, qui prête le temps long à l’esprit animal, juste pour frôler un instant un mythe de proximité.
Éblouissante connaissance de tous ces êtres qui se succèdent avec leur monde d’ailes, de poème en poème, avec leurs noms comme des formules magiques, et les couleurs de ces petits corps, repérées et notées précisément. Ainsi le petit tec tec de l’Île Bourbon (ancien nom de La Réunion), « ce petit joyau de l’île / à la poitrine rouge-bai / - d’un rouge qui s’adoucit - / au dos et à la gorge noires / que frange une bande de blanc ».
Au-delà des descriptions et de l’observation des comportements de ces nombreux êtres de ciel, des pauses. Telle « mésange bleue » va porter dans le poème, de nouveau, la brèche de l’interrogation, celle du langage, de ce qui peut ou pas être inscrit, et par quels mots. Que dit le poète, que vit le poète, que sait-il ?
« De quoi, de qui / suis-je mémoire ? / de toi, peut-être, // mésange bleue / ciselée sur / le blanc immense » [...] « si le Destin / tue les possibles, / si la voix meurt / de l’indicible / ou va mourir / dans un murmure ? »
La vie, et ce qui s’efface de la vie.
Douceur du regard, tendresse. Mais tout n’est pas doux dans le monde des oiseaux. Sacrifice de la mésange « qui ne peut plus suivre », et la mort, fin de tout vivant, mais qui pour l’oiseau, achève « sa connivence avec le ciel ».
Connivences ? Celles des mots pour nommer, en arabe ou en latin, et les sons, autre langage, de ces êtres volants. L’attitude du poète est l’écoute, percevant comme un concert, ou « dernier concert », cet univers pour l’oreille, « cette polyphonie splendide, / cette vaste trame sonore », offerte comme une consolation de l’inquiétude du temps, quand vieillir prive aussi de certaines parts du monde. Et, plus que consolation, l’écoute qui sait entendre aussi « leurs silences » rejoint une autre profondeur, celle « du sage d’Orient / lorsqu’il accorde sa pensée / au rythme secret de son cœur / accordé à celui du monde ». Je pense au soufi dansant ou au méditant zen... Alors que l’oiseau du dernier texte n’est lui-même « que poème / n’ayant d’ailes que ses syllabes, / que ses lettres pour exister », inscrit pour toujours dans le poème d’Eliseo Diego, cité.
........................
Le titre de la seconde partie (second recueil du livre) révèle une direction de pensée, L’Oiseau paradigme désignant la représentation de ce qui fonde la manière de comprendre la vie et le monde. L’oiseau est une clé, un signe, une langue à traduire.
Étrange et fascinant premier poème. Quel est donc cet auteur « inconnu » ? On lit en ayant le sentiment de parcourir un acide autoportrait qui pourrait être celui de bien des écrivains publiant des poèmes, qu’ils aient une bibliographie ample ou pas. Inconnu, Raymond Farina ne l’est pas, mais discret, oui. Et les poètes, même reconnus par leurs pairs, ne font pas la une des journaux. Il liste les incompréhensions possibles de ceux qui repèreraient « les occurrences / des métaphores obsédantes » ou « les étranges connotations / de sa constellation verbale », ceux qui « gloseront à l’infini / sur son indigente syntaxe / et sur son idiome autistique ». En fait c’est le portrait d’un certain monde littéraire critique, qui a sa toxicité. Je pense à l’ouvrage de Gabriel Audisio, précieux et aussi cinglant, Misères de notre poésie (1943). Reprenant certains éléments que Raymond Farina pose avec une distance lucide, on peut tout inverser. Cohérence d’un univers métaphorique, singularité d’une pensée (l’étrange ou ce qui est singulier et non compris par les distraits ou paresseux conformes), sagesse que la capacité du retrait dans le silence intérieur plutôt que la dispersion dans un bruit social. Et c’est bien cela : avoir « préféré aux distinctions / une superbe obscurité ». Même intention critique dans l’humour du jeu entre vocabulaire et concepts, ce qu’on dit « champ sémantique ». Humour, aussi, mais plus inquiet, au sujet des interdits de notre « Étrange époque », extirpant des mots et des sens des textes de la culture, quand « cette douce inquisition » veut réécrire les contes et les mythes...
Identité, réflexion sérieuse sur ce que le nom détermine, celui de « ce soi-même qui dure trop », et qui « mourra seul / à la fin d’une unique vie ». Gravité, la mort, et indispensables méditations, sous le titre « L’insupportable poids du monde »... Avec les « Questions à la Sibylle », qui sont posées à soi-même, sur ce qui suit la fin de vie, avec les représentations qui nous sont données par des siècles d’images (« un peuple d’anges ») et de récits de mythologies religieuses (« Enfer », « Paradis », « Purgatoire »...). Mais, esquisse d’autre pensée : « Combien de temps me faudra-t-il » [...] « pour comprendre, une fois pour toutes, / que rien n’a de commencement / et ne finit par conséquent ? ». Retour du « sage d’Orient » croisé dans un poème précédent... La mort comme illusion mentale (ce que disent bien des sagesses pour qui l’essence de l’être est non-née donc non vouée à mourir). Alors relire Cervantès ou Platon, « comprendre enfin tout Héraclite » ? Chercher la sagesse de Don Quichotte... « Et s’il tentait de s’opposer, / en faisant semblant d’être fou, / à un monde devenant fou / en faisant semblant d’être sage. / S’il incarnait la résistance / [...] à l’horrible loi d’efficience ? ».
Par contre la mort collective que peut se préparer l’humanité c’est un possible hélas envisageable, et la lucidité impose de le penser. Le poème « La crémation universelle » l’énonce, la folie de quelques-uns peut créer l’enfer général : « gratuite la crémation / - et de surcroît universelle ». Mort des hommes, « et le ciel n’a plus d’alouettes ». Alors... « oser rêver l’impossible » ?
Le livre s’achève avec les anges, en « Plaidoyer » pour les sortir des imaginaires des religions qui en font des justiciers, et peut-être les délivrer de la « logique » (« inutile ») et de la « raison » (« pas forcément souveraine »). Avec une autre rationalité, rêver : « J’aime les rêver créateurs, / filant le verre incandescent, / sauvant de l’amorphe l’argile / et insufflant au marbre une âme ». Il fait des anges des poètes au langage « musique d’ultra-monde » pour échapper à « la malchance d’être éternel ». Et, « riches de « poussières de rêves », rejetant le « mensonge ». L’ange, à la fin, est une figure réelle, de beauté terrestre et de joie jeune. Mais ces anges qui ne supportent pas leur éternité, cela fait penser à Camus évoquant la pensée de la survie de l’âme telle que conçue par Plotin (âme nostalgique de l’au-delà), et craignant, si cela était, une angoisse inverse, nostalgie de la terre et du corps... Et la jeune figure entrevue, à la beauté d’ange très incarnée, pourrait être l’image du regret des anges.
Recension, Marie-Claude San Juan
......
Je recopie le paragraphe de ma note du 10-06-2025 sur la revue Possibles n°35, où je rendais compte de ma lecture de ses poèmes :
« Lecture de textes, suite du numéro 35. J’ai d’abord lu les poèmes de Raymond Farina, sa volonté de se penser nomade, (« Passion nomade »), rejetant la nostalgie des « ciels d’enfance », la pensée profonde venue de « l’or infini d’un désert ». Lumière que cet or, son « sable » et en lui « chaque pierre embrasée ». Une matérialité qui nourrit la vision qui fait se rencontrer en soi des mémoires passées, les interroger, sachant le « lexique trilingue » enfui dans un temps perdu, avec un jardin, ses roses, et ses chants d’oiseaux, comme une image de réalité (« Attente de l’exilé »). Le passé c’est aussi le père, et l’exil du père, héritage qui redouble le sien (« Le père de marbre »). Est-ce un tel vécu qui crée cette lucidité des déchirements intérieurs sus (« Contradictions ») ? Reconnue, « Cette discorde en nous du clair et de l’obscur », mais vers « notre humanité », « ascendance à venir dont nous naîtrons peut-être ». Pas de lieu, réel ou mental, sans oiseaux dans l’univers de Raymond Farina (« Le legs de l’hirondelle »). Vivants ou morts ils enseignent, le faisant hériter d’un « legs immatériel ». Dans le présent c’est l’évocation des « femmes d’Iran et du Turkestan » (poème « Dévoilement »), espoir solidaire. Pour le regard c’est Van Gogh, ses « bleus » pour « saisir l’Infini », Vincent, sa détresse, sa folie. »
LIENS :
Les Grands Jaseurs de Bohême, suivi de L’Oiseau de paradigme, page éditeur, N&B Éditions : https://editions-n-et-b.org/wp/farina-raymond-les-grands-...
Présentation, revue Les Hommes sans Épaules : https://www.leshommessansepaules.com/auteur-Raymond_FARIN...
Page bio-bibliographique, Maison des écrivains : http://www.m-e-l.fr/raymond-farina,ec,706
Essai. Raymond Farina, L'Oiseleur des signes, par Sabine Dewulf, Éditions des Vanneaux (coll. Présence de la Poésie), 2019. Page librairie : https://www.librairiedialogues.fr/livre/16920643-raymond-...
Recensions précédentes, Trames nomades. Quatre recueils de Raymond Farina. Note du 01-08-2022 : http://tramesnomades.hautetfort.com/archive/2022/08/01/po...

Les commentaires sont fermés.