Lecture de La maison loin de la mer, de France Burghelle Rey
13/08/2025
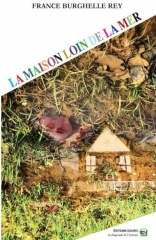 France Burghelle Rey a publié des recueils de poésie, surtout, et a notamment mené des recherches sur Cocteau, la théorie de la création, et Huysmans. Ce livre appartient (selon l’esprit de la collection La diagonale de l’écrivain des éditions Douro) à sa pratique périphérique (donc en marge des autres publications, mais parfois ce qui est périphérique devient une marque importante de l’univers d’un auteur). Ouvrage qui interroge, fait penser, force aussi à entamer une réflexion sur le genre où le classer, et partant d’une approche (en suivant le sous-titre) découvrir autre chose de très intéressant.
France Burghelle Rey a publié des recueils de poésie, surtout, et a notamment mené des recherches sur Cocteau, la théorie de la création, et Huysmans. Ce livre appartient (selon l’esprit de la collection La diagonale de l’écrivain des éditions Douro) à sa pratique périphérique (donc en marge des autres publications, mais parfois ce qui est périphérique devient une marque importante de l’univers d’un auteur). Ouvrage qui interroge, fait penser, force aussi à entamer une réflexion sur le genre où le classer, et partant d’une approche (en suivant le sous-titre) découvrir autre chose de très intéressant.
La Maison loin de la mer, Fragments I, Éditions Douro (coll. La diagonale de l’écrivain), 2021.
Ce qui m’a attirée vers cet ouvrage, est son sous-titre, Fragments... Mais j’ai ensuite remarqué autre chose, concernant aussi le titre : en référence des hauts de pages « loin » devient « près ». On doit donc supposer que la question du lieu est posée avec le signe de l’incertitude et que la mer devient un élément, réel et symbolique, central. Feuilletant, en commençant par la fin j’ai vu qu’un Index des noms d’auteurs mentionnés dans le livre prenait deux pages pour une longue colonne. Cela renvoie à de nombreuses citations, définissant sa pratique comme du glanage, se référant à Varda...
Fragments, il y a un deuxième volume qui a suivi celui-ci : Raisons secrètes. Saison nouvelle, Fragments II (2024). Découvrant les deux ensemble, j’ai préféré commencer par lire le premier.
Pourquoi la mention du terme « Fragments » m’a-t-elle interpellée ? Parce que l’écriture fragmentaire et aphoristique est ce que je situe à l’égal de la poésie comme art majeur d’écriture. C’est un océan dans la littérature, avec des sommets incontournables (Joubert, ses Pensées, Porchia, ses Voix... Et Munier, Mambrino, etc.... sous l'aura d'Héraclite). Mes premières publications ont été de fragments et j'y reviens. Camus, que j’ai tant lu, disait vouloir aller, pour sa future voie d'écriture, vers le fragment, l'aphorisme. Mais c'est déjà présent dans ses Carnets, dans Noces, L'Été, certaines pages du Premier Homme (et les annexes), diamants à recueillir (comme les Apophtegmes de María Zambrano, détachés de ses pages par Gónzalo Flores, éd. J. Corti). Et bien sûr, Camus, dans La Postérité du soleil, poèmes de proses fragmentaires. Le fragment c'est la densité, brièveté issue d'une fulgurance longtemps méditée. Ainsi l’œuvre de Jabès. Fragments... Je dis y revenir, mais en fait je crois que dans mes proses sur le regard, et même dans mes poèmes parfois longs, comme ceux du livre photos-textes de 2022, la structure se tisse autour de bases d'ancrages fragmentaires (voilà une réflexion que je vais devoir mener...). Fragments, cependant j’en trouve, plus loin, enfoncés dans des paragraphes, à extraire comme ce fut fait pour María Zambrano. (Ou comme l’a fait René Char, avec sa métaphore des livres tombés, éparpillés au sol, dont il aurait extirpé des fragments pour les regrouper, épurés, gardant la quintessence dans ses En trente-trois morceaux...).
Parcourant le livre je n’ai d’abord pas trouvé exactement ce que je définis comme fragments, mais autre chose. Car pour moi le fragment correspond à des écritures plus brèves, des textes plus séparés, îles de pensées émergeant de silences, et étrangères au récit. France Burghelle Rey a posé, elle, une distinction nette entre ses autres écritures (poème ou récit ou critique) et la démarche entreprise là. Et si je ne situe pas ses pages comme tout à fait des fragments (selon ma perception), je constate qu’il y a cependant une fragmentation, procédé littéraire qui a une portée particulièrement importante par ce qu’il peut signifier. J’en trouve une théorisation, une analyse intéressante dans ce qu’en a dit la romancière polonaise Olga Tokarczuk (dans un entretien avec Nicolas Weill, Le Monde du 29 novembre 2019). Pour elle, fragmenter un récit permet plus « d’accéder au vrai » que « la narration linéaire ». Ce qu’elle fait me semble correspondre à ce que fait aussi France Burghelle Rey. La romancière explique qu’il faut maintenant « un récit qui corresponde à notre expérience d’un monde morcelé, zébré, où l’on zappe... Comment, à partir de cette réalité éclatée, retrouver un sens unique ? ». Elle ne parle pas de fragments à la manière de Porchia, mais de « roman-constellation » et nomme sa technique « écriture fragmentaire ». Cette volonté de saisir dans l’écriture du roman une modalité du réel éclaté n’est pas étrangère à une démarche d’un autre type, celle de France Burghelle Rey, pour une étude de cette fragmentation des moments du vécu et de la mémoire autobiographique. J’ai donc vu, dans l’entreprise de son livre autre chose, qui n’est pas moins intéressant. Et lisant j’ai trouvé que sa recherche rejoignait, par l’esprit, les explorations intérieures de Peter Handke (quand lui aussi il écrit en périphérie de ses récits, et fragmente son écriture) ou celles de Charles Juliet, spéléologue des profondeurs. Et j’ai pensé aussi, en déplaçant la réflexion d’écriture à peinture, au Journal d’Odilon Redon, à soi-même (Corti). Le sous-titre de La Maison loin de la mer deviendrait Explorations I... Ce livre correspond parfaitement à l’esprit de la collection qui l’héberge. Cette notion de périphérie est très juste, riche, et pousse à réfléchir sur la question des axes dans la pratique de l’écriture, et au centre dont ces livres sont des marges qui ont certainement effet sur cette autre écriture centrale.
Repères. La dédicace est un adieu à une amie décédée qui est évoquée dans l’ouvrage. La pensée de la mort est souterrainement une coloration, même pour des passages qui peuvent traiter d’autre chose. Exergues : citations d’Apollinaire, Nietzsche, Pilinszky. Et Mallarmé. Ou la joie et le lieu. Donc programme de dépassement. Après avoir vu cela j’ai lu la lettre du poète Michel Ménaché, qui est donnée « en guise de postface ». Lui aussi semble hésiter sur le genre d’écriture : « Poésie-journal ? » se demande-t-il, notant une proximité avec Colette (le lieu, l’ancrage)... Il apprécie « l’alternance prose, poèmes », retient le terme qu’elle a forgé : « autobiopoésie », ajoutant que « ce sont les livres qui prennent le pas sur le vécu », mais voit son écriture comme outil de « réparation de soi », regrettant cependant le « patchwork de citations », trop pour lui, même s’il reconnaît la pertinence de « l’étayage littéraire ». Moi, cependant, j’aime la présence de ces traces des lectures, des clés données par des auteurs qu’elle rejoint par tel ou tel vécu, telle ou telle réflexion. J’y lis un enracinement dans des œuvres qui ont nourri, interrogé, enrichi celle qui écrit. Nos écritures naissent d’un héritage de textes dont nous sommes imprégnés : pas d’écrivain qui ne soit lecteur, et les traces qu’on offre (exergues, citations) sont l’inscription de filiations, le paiement de dettes, et un cadeau au lecteur (double : ainsi il situe l’auteur, et il s’enrichit de ces références). Il y a un livre que j’adore, où Claude Roy fait pire, en matière de citations. Dans Sais-tu si nous sommes encore loin de la mer ? (qu’il sous-titre en « épopée cosmogonique [...] en douze chants et en vers »). Car s’il n’y a que deux exergues (Bossuet et Joyce) tout le livre est une alternance qui allie ses textes et de très nombreuses citations en italique (le « chœur »), les références étant données en fin de livre, page à page. C’est un grand poème et une anthologie mêlant les cultures et traçant l’épopée des temps humains. J’aurais aimé y penser avant lui (il faudrait inventer autre chose).
Dès la première page la recherche est éclairée, et ce mot « maison » du titre : « Le lieu est en moi car il a suscité la poésie qui est à son tour un lieu ». La peur de la perte associe les deux : « Si l’on prend ma maison », « Si on me prend ma langue »... La force de ce lien est ce qu’on interroge dans « ce mystère du lieu », au point que cela soit porté dans le champ du sacré : « Si ce lieu est sacré je suis son oblat ». Il y a le lieu (mais « Combien ai-je donc de mondes ? ») quand « un seul » compterait. Le temps de l’enfance se mêle au temps de l’écriture dans le présent, on ne sait pas tout comprendre car tout est suggéré, esquissé. Et si je ne vois pas d’écran
dans la masse des citations, je perçois un flou volontaire, comme un procédé photographique qui met une distance pour recouvrir des émotions ou les révéler autrement, flou paradoxalement non corrigé mais aidé par les citations glissées.
Que fait ce qui se pense « autobiopoésie » ? Y a-t-il autobiographie malgré ce flou ou par ce flou ? Mais peut-on saisir sa vie en tentant le récit de moments, de douleurs, d’aspirations confrontées au processus de l’écriture ? Peut-être que dans cette entreprise seul compte l’opération de la mise en mots. Car entre la vie et l’écriture de la vie se creuse un espace impossible à franchir. Je pense au questionnement de Pascal Quignard dans La vie n’est pas une biographie (donc pas plus une autobiographie...). Quand il écrit ceci : « Nous sommes tellement hétéronomes [...] tellement savants, tellement influençables, tellement érudits. Nous sommes tellement devenus une "personne" humaine ; une personne grammaticale ; un masque ; le porte-voix d’une autre voix. Or dans les plus beaux instants du temps gémit dans notre bouche une langue qu’elle ignore », il pose cet impossible espace. Alors que faire de ce qu’on lit ? La réponse c’est un personnage d’un récit d’Anne Dufourmantelle qui la donne, dans Souviens-toi de ton avenir. Déchiffrant un manuscrit il déclare : « Il faut aller plus loin que le narrateur... Entrer dans sa pensée, lire entre les lignes tout ce qu’il n’a pu écrire, et là : trouver une porte. Qui existe par le texte et hors le langage. [...] une fracture verticale, un hors-temps. »
Or j’ai l’impression que France Burghelle Rey, dans sa recherche pour penser le double lieu où être (maison/région et écriture), casse la distance entre qui écrit et qui lit et se fait elle-même expérimentatrice d’un déchiffrement de l’autre en elle. C’est pourquoi la masse des citations ne me dérange pas, car j’y vois le moyen d’opérer la mise en place de cette « fracture verticale ».
Sentir ? « j’accepte qu’il n’existe pas / de joie sans souffrance / que le pire est / de ne rien sentir ». Et, commentant : « Chaque mot de chaque poème n’est-il pas une acmé ? ». Oui, si écrire est une fin de parcours, le point ultime d’une révélation intérieure. Mais laquelle. Elle mentionne le point de vue d’une amie : « Ton lieu est métaphysique et tu as toujours été quelque part mystique ». Réfléchissant elle adhère à cela, constatant que son écriture est, par ce livre, « une quête du spirituel ».
Fragments, je les repère. Ainsi, bien après avoir cité François Cheng, sa sérénité de sage sachant l’ici, elle écrit : « Le poète est un glaneur quotidien ». Et, méditant après avoir relevé une réflexion de Christiane Singer sur le vieillissement et la mort, elle inscrit ceci : « Les mystères sont les mêmes pour tous. Restent les formes pour les dire ». Les citations provoquent un recul, une distance avec ses phrases, autorisant une capture dense de sa propre pensée, comme si elle se citait elle-même, retirant un éclat, un instant, de la coulée des pensées. Citer devient une méthode interne (le ciseau pour les autres, donc le ciseau pour soi). Et c’est un vers : « Reste aussi l’instant pour valider l’éden ». Georges Schehadé l’ayant lu l’aurait gardé pour son Anthologie du vers unique. Parcourant le livre je trouve des éclats qui se suffiraient, glissés dans les pages, entre des phrases, parfois dans des phrases. Comme sur l’attente (p. 50) ou sur la souffrance (p. 51) : « La souffrance, contraire à la joie, entache le sacré ».
Mais ce livre est une méditation qui a besoin de développement pour étudier l’écriture comme « épreuve », tant physique que psychologique, par la descente parfois dans le « trop profond en soi ». Questionnement sur le temps de la création, en évoquant des auteurs qui ont travaillé longtemps sur un seul ouvrage. Dernier glanage, Michel Leiris, pour un livre qui serait « tout », et cette notion de « perpétuel work in progress ». Perspective proche de son projet, hors des genres. Non classable. Et peu importe. Car « écrire, c’est écrire, c’est écrire, c’est écrire » (Gertrude Stein).
Recension, Marie-Claude San Juan
.............
LIENS :
La Maison loin de la mer, Fragments I, page éditeur, Éditions Douro :
https://www.editionsdouro.fr/boutique/La-maison-loin-de-l...
Raisons secrètes. Saison nouvelle, Fragments II, page éditeur, Éditions Douro :
https://www.editionsdouro.fr/boutique/Raisons-secretes-p6...
Blog personnel, France Burghelle Rey : https://france-burghellerey.over-blog.com/

Les commentaires sont fermés.