Trois livres d'Éric Desordre...
20/07/2025
 Trois livres d'Éric Desordre, 2023, 2024, 2025...
Trois livres d'Éric Desordre, 2023, 2024, 2025...
Des catégories différentes. Notes de mémoire sous l’ombre éclairante de Perec, fragments pour évoquer le voyage en sommets, Asie, et entretiens regroupés, pour découvrir des êtres avec lesquels il reconnaît une affinité, et des univers de liberté qui répondent à ses aspirations.
.......
J’ai arraché la dernière page, Éditions Unicité, 2023, 132 pages.
Livre dédié à Jean-Luc Maxence et Danny-Marc, éditeurs du Nouvel Athanor (et de la revue Les Cahiers du Sens, jusqu’à 2020), fondateurs du magazine Rebelle(s) dans lequel Éric Desordre joue un rôle important. En exergue Emil Cioran et Yves Bonnefoy, deux citations sur la mémoire, ce qui peut être compris comme une première traduction du titre. La dernière page est peut-être le dernier souvenir, et la mémoire ce qui arrache, rejetant aussi (ou au contraire, arracher pour garder). En quatrième de couverture Brigitte Gins-Cohen utilise le terme de Journal pour qualifier cet ensemble, et note l’humour « souvent caustique ». De son texte je copie la dernière phrase que je trouve éclairante : « À la croisée de la prose poétique, du journal intime et des paraboles ironiques, la résurgence savamment désordonnée et chaotique de la mémoire exprime pour le monde, ceux qui y vivent et ceux qui y ont vécu, une immense tendresse. »
Avant de lire j’ai regardé la table des matières qui classe des « rubriques », regroupant des sujets, comme « Décryptages », ou « Culture ». Les thèmes sont très divers, volonté de brasser un ensemble pour faire en quelque sorte le portrait d’une société et d’une époque. Le lecteur peut choisir en fonction des titres des chapitres et sous-titres des fragments. Mais le portrait est aussi celui de l’auteur en miroir, par retour sur des vécus, même d’enfance.
Le premier texte, « Vide-greniers » évoque, première ligne, Georges Perec, son livre Je me souviens. « C’est curieux la mémoire », note Éric Desordre. Car on peut s‘étonner de la futilité apparente des souvenirs qui reviennent, ramenant à soi des objets, des meubles, des vêtements, mais c’est un univers de choses auxquelles s’attachent des affects, comme ces petites voitures que tous les garçons ont adoré collectionner. C’est tout un monde qu’on revoit aussi, lisant. Parmi tout ce qui est évoqué je remarque particulièrement son « premier appareil photo » et le suivant. C’est important car à l’origine de la naissance d’une vocation, le commencement de la pratique d’un art, en photographe qu’il est de plus en plus devenu. Comme pour Perec les souvenirs se mêlent dans un apparent désordre, mais on voit cependant un cheminement dans l’apprentissage des émotions et l’initiation aux questionnements idéologiques et politiques. Les premiers voyages sont eux aussi la trace d’un commencement important.
« Généalogie », c’est la mémoire de ceux qui précèdent et accompagnent, la conscience de ce qu’on hérite, en soi, d’eux : « Ils sont moi, je suis eux ». « Ataraxie », ou un rêve de stoïcien, dans la tranquillité de vacances familiales, la paix dans la nature et des loisirs simples, l’image de « l’eau verte » du canal du Midi, « qui coule sans qu’on le perçoive ; brume tiède, bulle qui remonte de la vase ». Puis les notations de vie estudiantine, surtout les faits en marge (repas, fêtes, rencontres...). Au fil des pages des pointes entre aphorisme et récit, pour des regards qui survolent les instants remémorés. Épisodes témoignant d’amitiés pour des êtres dont certains sont remarquables par leurs itinéraires de vie. La mémoire rappelle même des repas, car ce qui se mange révèle aussi des moments, comme les sports, le scoutisme. C’est léger et ce n’est pas léger, car intervient l’Histoire, et la guerre (les cimetières de l’Est), la mort. Conscience des classes sociales, aussi.
Retour à l’enfance, premières lectures, Journal de Mickey et bandes dessinées, science-fiction, romans classiques, découvertes en désordre. Pas de mémoire sans musique (rock, Bob Dylan, Ennio Morricone), pas sans images (télévision, cinéma).
Dernière phrase, Sami Frey au théâtre jouant Perec, Je me souviens. Le livre marque un cycle, de Perec à Perec.
...............................................................................
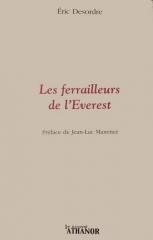 Les ferrailleurs de l’Everest, Le Nouvel Athanor, 2024, 79 pages.
Les ferrailleurs de l’Everest, Le Nouvel Athanor, 2024, 79 pages.
La préface est de Jean-Luc Maxence, qui fait l’éloge tant du poète que du voyageur en Asie des sommets. En quatrième de couverture, Danny-Marc, elle-même voyageuse passionnée, insiste sur la particularité de ces voyages en « altitude », « au bout du monde ». La dédicace de l’ouvrage est offerte à l’alpiniste Patrick Gabarrou, le citant : « Nous ne sommes pas faits pour ce qui est fini, mais pour l’infini ». Cela correspond bien à une autre pensée de cet aventurier des sommets, citation que j’ai trouvée par hasard dans un article : « La montagne élève le regard, le cœur et l’âme ». Avec ce nom, Patrick Gabarrou, l’axe du livre est donné, l’intention, une dimension de spiritualité authentique, quelle que soit le nom qui puisse la définir. Regard, oui, voici le lien avec l’infini, la recherche de beauté du poète-photographe. Deux exergues. Hermann Hesse, pour le regard sur le réel, modifié, et l’union avec ce qui est vu, perçu : « Maintenant, il était auprès de ces choses, il en faisait partie ». Et Montaigne, pour la sagesse de l’accueil de ce qui est : « ce qui m’est donné ».
Deux parties. « Népal dans la brume » (Automne), et « Aux montagnes, vers les forêts » (Hiver). Les titres des chapitres ont deux fonctions, situer lieu et temps, d’une part (donner des repères), et indiquer une direction (un sens, un climat intérieur). Toute la structure est composée de proses agencées selon un double itinéraire (le voyage, extérieur, et la démarche intime). Je remarque l’alternance entre des textes denses, d’une page ou deux, rarement plus, et des fragments, bien isolés, distincts de ce qui précède, dans lesquels domine encore plus le regard, avec des notes de couleur, mêlant la mention du concret, accentuée par la brièveté, et la notation d’un écart entre certaines trivialités des choses vues et la dimension sacrée de l’univers traversé.
Premier texte d’automne, « La ville des signes », Katmandou. Une image qui ne correspond pas aux chroniques habituelles qu’on peut lire dans des récits de voyage à la découverte de cette ville. C’est une photographie ironique et poétique, avec ces fils électriques mêlés en spirales multiples où le voyageur voit « de gigantesques barbes à papa ». Ville « des signes » pour la présence d’innombrables messages (annonces, publicités, slogans) envahissant « le moindre à-plat vertical ». Modernité dans la pauvreté. Ici, « tout est courage ». Départ, c’est « Une route des possibles ». Bus, pour quitter la ville vers « les pentes pré-himalayennes ». La route révèle aussi une multitude. Camions, voitures locales avec l’effigie de Bob Marley alors que plus haut règne Shiva, « statue géante ». Humour, les « possibles » de cette route croisent les frayeurs de l’émission sur les routes de « l’impossible », roue dans le vide comprise. Heurt, « les détritus qui jonchent le moindre sentier » et la beauté d’une « nature sublime ». Heurt, encore, les habitants ne semblant voir que le sacré « partout ». Comment situer la « recherche spirituelle », du voyageur dans cet univers sacré différent ? Pays du Bouddha, le Népal, rappelle-t-il, mais pays hindouiste. La nature... Des « arbres immenses, d’essences inconnues » et d’autres plus communs, et toujours la pluie. Animaux, des singes. Lac « sacré », ses baigneurs « dévots », et « les restes des offrandes à Shiva » jetés tout autour, encore cet étonnant mélange. Un fragment résume en une ligne cette partie du voyage, son univers : « Des singes mouillés au lac sacré, eaux ». Expression d’un des compagnons du voyage, « La boîte à rêves » est en fait rêve d’ascension.
Deuxième partie, Hiver... Katmandou, de nouveau, et départ vers les routes. Étape, lieu des moines et de statues « couvertes de safran » et « lunette astronomique » des moines. Ensuite, regard critique sur l’aberrante file de « grimpeurs » d’Everest, l’exploitation (dangereuse) des sherpas. Il va participer à un projet (« équiper un nouveau passage ») avec des « barreaux d’acier ». D’où le nom de « ferrailleurs de l’Everest ». Entreprise avortée, trop de froid. Retour à Katmandou. Hôtel, le blanc de l’humide chambre, impression de vide. Questionnement existentiel et plus, sur la perspective qu’évoque la culture de ces lieux, malgré les mendiants dans les rues, la pensée de l’Éveil. Le pays serait-il un temple qui force au retour sur soi, pour mesurer le chemin (« encore loin de l’Éveil ») ? Lui et ses amis repartent, vers l’Inde, longeant une rivière sans l’atteindre. Animaux, en marge des villes ou dans la forêt, éléphants domestiqués ou pas, et traces de tigres. Rivière, univers d’oiseaux. Bus, ville, les gens, vie foisonnante. Départ, avion. Dernier mot : « voyage ».
...............................................................................
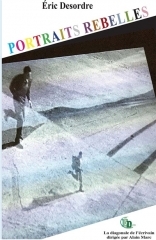 Portraits rebelles, Éditions Douro (La Diagonale de l’écrivain), 2025, 278 pages.
Portraits rebelles, Éditions Douro (La Diagonale de l’écrivain), 2025, 278 pages.
D’après l’axe indiqué dans la présentation de la collection (« mettre en lumière ce qui forme l’univers périphérique d’un auteur », sa « trajectoire en diagonale ») ce livre y répond doublement. Périphérie de l’auteur, l’art de l’entretien, et périphéries des personnes interrogées. L’ouvrage est dédié à Jean-Luc Maxence, créateur du magazine Rebelle(s) qui accueillit des entretiens regroupés ici. Éric Desordre définit d’abord ce qui relie ces êtres dont une sorte de portrait est tracé à travers les réponses qu’ils font à ses questions. Je relève deux mots, « fraternité » et « altérité ». Pour qualifier ce qui relie les sujets de ces entretiens il retient plusieurs points communs : « culture » « douleur », désir de « transmettre », « liberté ». Et de tous il retient la qualité d’êtres « rebelles », au sens d’une différence, d’un décalage, une « discordance vitale ». Reprendre chaque entretien n’aurait pas beaucoup d’intérêt. Tous sont précédés d’une introduction qui fait entrer dans l’univers de celui qui répond et situe aussi la démarche de celui qui questionne, le contexte.
Ainsi on découvre l’univers d’exil de l’écrivain Salah Al Hamdani, d’origine irakienne. Puis son itinéraire intellectuel et créatif, passant par l’importance particulière de Camus pour qui il est venu en France, et en qui il trouva « une grande porte ouverte ». Écrire, pour lui, c’est « prendre la parole », pour « éveiller les autres ».
Si Alejandro Jodorowsky a accepté l’entretien c’est pour avoir perçu que le magazine Rebelle(s) était dans un univers « un peu initiatique », axé sur la spiritualité. Pour lui « Ce qui compte c’est le développement de la conscience ». Selon lui, 92 ans et demi alors, c’est vieillir qui fait « ne plus avoir peur », car « Là commence la véritable rencontre avec soi-même ». À la question qui porte sur les religions et « la connaissance de l’invisible » qu’elles permettraient, Alejandro Jodorowsky répond qu’il distingue « la pensée religieuse et la religion elle-même ». La première est « mysticisme », la religion « est limitée ». Il développe une réflexion sur la conscience, de soi, de tout, et l’imaginaire, l’illusion. Mais il ne réduit pas le fait d’être à du néant, car « tout est vie » : « Même les pierres participent de la vie, tout est vie. Il faut considérer, englober tout, l’Univers entier. La totalité. » Conscience à avoir, pour l’humanité, « de sa propre finitude », et « de ce qu’elle fait de désastreux au monde, aux arbres, aux autres êtres vivants ». Constat : « La civilisation humaine est malade ». Mais sans désespoir, si des « Justes » peuvent sauver. Et foi en la poésie : « La poésie c’est le sommet de la pensée humaine. Mais plus profonde est la poésie moins de lecteurs elle a ». Répondant à une question il parle de sa méthode de « psychomagie », des archétypes à « rechercher en soi », pas à l’extérieur, du tarot qu’il enseigne, et évoque son art de la bande dessinée.
D’autres entretiens font aborder la mort, la sociologie, le culturisme, l’art dramatique, le chant, l’alpinisme, et on voyage dans l’univers de poètes lointains, jusqu’à Haïti.
Étienne Ruhaud, poète et éditeur, est passionné par les cimetières, d’où le titre « Le gardien d’éternités ». En quelques mots Éric Desordre définit son univers : « Alchimie littéraire, imagination surréaliste, évocation des ombres ». Se racontant Étienne Ruhaud parle de son travail au Louvre, métier qu’il aime assez. Puis du Père-Lachaise, qui, à Paris, « ville-monde », est pour lui un « cimetière-monde ». Il cite de nombreux noms, cendres internationales... Son intérêt n’est « pas morbide ». Au contraire, ce qui l’intéresse c’est « resituer », car il dit être obsédé par la disparition « des civilisations, des peuples, des livres » avec « angoisse ». Et donc « Un cimetière, c’est un moyen de ressusciter des histoires ».
On rencontre ensuite un prêtre chanteur, spécialiste de Tintin, puis Pascal Thuot, un lecteur passionné par la science-fiction et le cinéma américain, pour « l’imaginaire débridé », « l’autorisation à rêver à autre chose ». Arrêt sur la poésie avec la créatrice du festival de Lodève, qui a lieu maintenant à Sète. Alain Duault, poète, retient de la poésie le « surgissement », contre le « vouloir-dire ». (Il a préfacé le livre d’artiste d’Éric Desordre, Chasse avec les fantômes, créé avec le peintre Jérôme Denoix, éd. Unicité.)
Pages suivantes, Mattéo Vergnes, poète et peintre, aborde l’émerveillement, citant Christian Bobin (« Le poète est celui qui sait s’émerveiller de tout et de rien »), et Thoreau (« S’émerveiller est une capacité qui demande à être lent comme la pratique de la marche »). Il pense « réflexion » pour l’écriture, et « énergie » pour la peinture. En commun, « la vibration de la rature ». De la poésie il ajoute qu’elle est « un outil de sagesse », « une sorcellerie », « Une sorcellerie du regard car avant d’écrire et de décrire le monde, il faut déjà le regarder, le comprendre et surtout le vivre ». Peinture, il précise où se situer, et évoque l’art brut, préférant la notion d’art singulier, d’artistes qu’il estime.
Dernier entretien, Catherine Pont-Humbert, à l’occasion d’une résidence d’écriture à Vezelay. Interrogée sur le processus d’écriture elle distingue l’écriture des poèmes et le travail de « polissage », ensuite. Alors elle travaille sur les mots, « outil » et « matière » de la poésie. Des noms : Philippe Jaccottet, Camus (Pour L’Été et Noces, oui, c’est juste, mais elle ne cite pas son livre posthume La Postérité du soleil), et ajoute Giono (effectivement...). Elle note qu’ils « ne sont pourtant pas répertoriés dans la famille des poètes ». Ce n’est pas tout à fait exact. De Camus le poète Nimrod considère qu’il est l’égal de Rilke. Et parmi les colloques et essais critiques sur Camus de plus en plus certains ont porté sur la poésie (ces chercheurs plus nombreux à penser que la poésie n’est pas que genre, et pas que vers, comme elle citant Camus et Giono). Importance, pour elle, de la mémoire, « le socle de toutes choses ». Lieu particulier que Vezelay, et la résidence était dans la maison de Jules Roy qui a tant aimé l’univers spirituel de la ville et de sa basilique (et tant écrit sur ce lieu), ayant réussi à retrouver là un ancrage.
Recensions, Marie-Claude San Juan
LIENS :
J’ai arraché la dernière page, Éditions Unicité, 2023 : https://editions-unicite.fr/auteurs/DESORDRE-Eric/j-ai-ar...
Les ferrailleurs de l’Everest, Le Nouvel Athanor, 2024. Page libraire (lire « Alors fermons les yeux et laissons-nous guider...) https://www.eyrolles.com/Litterature/Livre/les-ferrailleu...
Portraits rebelles, Éditions Douro, 2025 : https://www.editionsdouro.fr/boutique/Portraits-rebelles-...
Recensions précédentes :
Le Chemin derrière l’étoile, Unicité, 2020, et Le Feu au gorille, Unicité, 2021 : http://tramesnomades.hautetfort.com/archive/2022/07/11/de...
Tu avanceras nu, Unicité, 2019 : http://tramesnomades.hautetfort.com/archive/2021/05/06/pa...

Les commentaires sont fermés.