31/07/2025
Vers d'ultimes (im)pulsions, livre de Roland Chopard
 Ce livre de Roland Chopard poursuit une démarche singulière, commencée par l’exploration menée dans Sous la cendre, réflexion, ou plongée dans les profondeurs du mystère de ce qu’est la genèse de l’écriture quand il s’agit de retrouver les bribes d’un manuscrit perdu (dans un incendie). Travail de deuil et paradoxalement venue à l’écriture autrement, naissance à une expérience d’écrire révélée par cet événement. Il a continué cette enquête de scripteur dans les ouvrages suivants (Parmi les méandres. Cinq méditations d’écriture et Progressions, voir en fin de note les liens vers les recensions précédentes). La seule pause fut le livre que nous avons réalisé ensemble, où le sujet était le regard, à partir de mes photographies, pratique qu’il mène parallèlement puisqu’il est aussi plasticien (ce qui intervient d’ailleurs dans ce qu’il réalise en tant qu’éditeur à AEncrages).
Ce livre de Roland Chopard poursuit une démarche singulière, commencée par l’exploration menée dans Sous la cendre, réflexion, ou plongée dans les profondeurs du mystère de ce qu’est la genèse de l’écriture quand il s’agit de retrouver les bribes d’un manuscrit perdu (dans un incendie). Travail de deuil et paradoxalement venue à l’écriture autrement, naissance à une expérience d’écrire révélée par cet événement. Il a continué cette enquête de scripteur dans les ouvrages suivants (Parmi les méandres. Cinq méditations d’écriture et Progressions, voir en fin de note les liens vers les recensions précédentes). La seule pause fut le livre que nous avons réalisé ensemble, où le sujet était le regard, à partir de mes photographies, pratique qu’il mène parallèlement puisqu’il est aussi plasticien (ce qui intervient d’ailleurs dans ce qu’il réalise en tant qu’éditeur à AEncrages).
..........................
Vers d’ultimes (im)pulsions, avec les encres de Jean-Claude Terrier, L’Atelier du Grand Tétras, 2025, 56 pages.
Il y a une sorte d’évidence dans l’accord entre les encres de Jean-Claude Terrier et les textes de Roland Chopard. Les tracés des encres relèvent aussi de l’écriture. Affinité créatrice, car dans ces encres qui peignent aussi la matière encre, celle d’avant les mots, on sent la dynamique du surgissement.
Dès le prologue, dans le premier fragment, c’est d’ailleurs le mot « surgissement » qui est noté comme un appel adressé à soi-même, ou l’affirmation d’une permission à se donner, accentuée par l’emploi de l’infinitif : « Favoriser » [...] « tout mettre en œuvre ». Car ce qui vient s’écrire tient à un état d’écriture, à l’accueil de ce qui permet à cet état d’advenir et de perdurer. Laisser aussi agir le hasard dans le rapport entre les émotions et les mots, par « d’aléatoires cheminements ». Accepter, dans la dispersion qu’imposent les « tâches » du quotidien, de noter, même, « des bribes éphémères ». Alors peut émerger « un acte essentiel de liberté ». Roland Chopard écrit, inscrivant des « signes », mots et phrases. Quand il écrit « Ne pas y chercher des thématiques », s’adressant à lui-même avant tout lecteur futur, on ne peut que penser à Yves Bonnefoy, affirmant : « un poète n’a pas de thèmes, mais des mots ». Car dans cette méditation sur l’écriture qu’est ce prologue, c’est aussi cela qui s’affirme : « Ces mots » [...] « seront les stigmates indélébiles d’intentions profondes venues se fixer là ». L’essentiel est « une attitude fondamentale de perception ».
Techniquement le choix, naturel, est celui d’une « prosodie simple », et (ce qui peut sembler plus paradoxal mais confirme le refus des « artifices littéraires ») rejet des « images », le but étant « une économie de mots et de références ». Analysant l’évolution de son écriture il en note la métamorphose qui aboutit à épurer la force des « charges émotionnelles », « pour laisser la place à une expression de plus en plus cérébrale ». Il y a là une très forte conscience de la « pratique singulière » de l’écriture qu’est la sienne, et qu’il veut telle.
Créer et le faire dans un espace intérieur de vigilance. Car il faut aussi écarter les sollicitations extérieures pour être à l’écoute du « monde intérieur », ce qui ne se peut pas sans décider de ne recevoir que ce qui correspond à l’enjeu essentiel de la démarche de pensée et d’art, sachant que c’est « un acte ardu, mais librement assumé ». Plus loin encore dans l’exigence, ce dépouillement des moyens poétiques « atténue le moi », libérant « une part indéfinie d’altérité et de connivence ». L’infinitif que j’avais repéré dès la première phrase il en fait « un outil, une référence pour le recul, le détachement et l’ouverture dans l’écriture et la lecture ». Reste le travail sur la langue et le leitmotiv de l’infinitif comme cadre, le « questionnement » constant portant sur la « matière poétique ».
Il n’y a pas de table des matières, mais une structure. Trois parties, titrées « 1er tourment », « 2ème tourment », « 3ème tourment ». Les textes sont des fragments en prose, de quatre à cinq lignes, parfois six. Comme l’inscription des temps fractionnés d’une méditation. Que signifient ces titres, quel tourment est interrogé chaque fois ? Ce ne sont pas des tourments d’angoisses existentielles, même quand la mort est évoquée, mais des questionnements ne concernant que l’entreprise d’écriture.
Le « 1er tourment » serait la crainte de « demeurer interdit », arrêté devant un vide. Le « doute » et toutes les questions qu’il entraîne, doute « qui est pourtant constitutif de l’écriture ». Garder ces mots ? les rejeter ? Trop écrire ou trop peu ? Aller au-delà de ces perturbations c’est « trouver l’entre-deux qui serait la juste mesure entre la parole et le silence ». Et espérer le « partage » par la lecture qui reconnaîtra la dimension, dans l’écrit, de ce qu’il y a « d’intime et universel ». Volonté de faire demeurer la « tension » nécessaire, l’essentiel étant les « préoccupations esthétiques ». Refuser tout « pathos » et « sentimentalisme » pour préserver la « méditation », cette attitude intérieure, et fuir les pièges « illusionnistes ». Être loin de « cette littérature qui cherche absolument à divertir ». Maintenir le choix des « extrêmes du minimalisme de l’expression ». Dans la lecture d’autres écritures, obscures ou brillantes formellement, reconnaître la distance prise, et de « rituel » d’écriture en « méditation » à tracer, assumer de procéder (en interférence avec ces refus) à « la naissance d’une nouvelle écriture ».
Autre tourment. Que ce qui est écrit, ayant traversé les doutes, soit menacé, comme c’est le cas ailleurs, jusqu’à l’emprisonnement, ou que tel manuscrit soit détruit par une catastrophe, comme comme celle qui provoqua la disparition du livre dont Sous la cendre rend compte. Mais le paradoxe est que la cendre bien réelle est devenue la source de l’accès à une autre manière de penser et créer l’écriture, produisant une autre identité d’écrivain. Cette partie prolonge la réflexion menée dans l’ouvrage Sous la cendre qui fait le récit de cet anéantissement. Car c’est un événement fondateur, de plus en plus fondateur. Résilience, il le sait, dans le processus de rétablissement de l’écriture, mais bien plus, car il n’y a pas que guérison mais dépassement et investissement de la charge symbolique de la cendre, et, plus, de la charge matérielle, concrète, et, même, alchimie du langage, de la charge des lettres : « Comment assumer ce lien entre la cendre et l’encre, autrement que par le fait que le mot cendre contient toutes les lettres du mot encre ? ».
Là il faut revenir sur les encres de Jean-Claude Terrier car elles inscrivent cette fusion cendre et encre. Elles peuvent figurer non le feu mais la noirceur de ce qui a brûlé, qui n’est plus que trace sombre, noire ; elles représentent ce qui pourrait être l’évocation calligraphique de ce qui précède l’apparition de la lettre.
Dernier tourment, une autre réalité de la cendre, « la sensation de la mort », agissante dans la venue à l’écriture, et la conscience de « l’inéluctable », sa propre disparition. Ce ne sont pas des « évocations morbides », mais un « constat ». L’écriture doit se saisir de cela, faire passer l’inéluctable naturel au « culturel » Écrire en pensant au « post mortem » des textes ? Non, donner du sens dans le moment de l’écriture. La cendre du papier brûlé est devenue « la trace ultime du corps », et, (il cite Derrida) « un reste sans reste ». Faut-il écrire un « tombeau » (comme celui, inachevé, qu’il mentionne, de Mallarmé pour son fils) ? Ou rédiger, note-t-il, comme Johann Jacob Froberger, une Méditation faite sur [sa] mort future ? Au moins « anticiper » par la pensée. Savoir que l’écriture qui est née de la mort la métamorphose en expérience mentale de création, alors que ce qui est écrit... l’est. Ce qui a été dépassé permet de penser l’horizon d’une « certaine sagesse », forgée par les choix de sobriété formelle. Au point de pouvoir noter « cendre » en dernier mot du livre, l’écriture ayant fait traverser tous les sens de ce « reste sans reste » formulé par Derrida et médité dans les pages de Roland Chopard, comme paradoxe d’un long procédé d’effacement qui laisse des traces de lui-même, mots et pages, livres.
L’ouvrage est une méditation accomplie, aboutie, où l’écrit qui se crée pense la création, tout commencement et toute fin, cycle où les deux temps extrêmes se rejoignent, en sérénité.
Recension, Marie-Claude San Juan
LIENS :
Vers d'ultimes (im)pulsions, page éditeur, L’Atelier du Grand Tétras, 2025 : https://www.latelierdugrandtetras.fr/parutions.php?livre=...
AEncrages &Co, La couleur des yeux : https://www.archipel-butor.fr/aencrages-co-la-couleur-des...
AEncrages : https://www.aencrages.com/a-propos/
Recensions précédentes :
Sous la cendre, Lettres vives, 2016. Note du 03-07-2016 : http://tramesnomades.hautetfort.com/archive/2016/07/03/so...
Parmi les méandres. Cinq méditations d’écriture, L’Atelier du Grand Tétras, 2020 (et des liens complémentaires) : http://tramesnomades.hautetfort.com/archive/2021/04/22/le...
Progressions, Bruno Guattari éditeur, 2021. Note du 30-05-2022 http://tramesnomades.hautetfort.com/archive/2022/05/30/pr...



















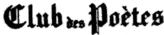




Les commentaires sont fermés.