10/05/2025
L'Intranquille n°27, revue
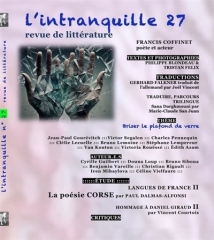 Riche numéro, séquences diverses : entretiens, traductions, (dossiers : traduction, poésie corse), poésie, chroniques critiques...
Riche numéro, séquences diverses : entretiens, traductions, (dossiers : traduction, poésie corse), poésie, chroniques critiques...
« Changer d’art, changer d’air » (pp. 3-5), juste titre pour introduire l’entretien de Françoise Favretto avec Francis Coffinet, qui crée dans deux domaines très différents, trois même. Écriture, cinéma, peinture (j’ai vu une de ses expositions). Cinéma, il se sert de son visage (il ajouterait certainement de son corps, comme tout acteur), mais au visage il donne une force de signification particulière, créant des personnages fort loin de celui qui écrit.
Françoise Favretto l’interroge sur son goût de la lecture à voix haute, sur ses « rôles un peu effrayants, impressionnants ». Elle s’intéresse au passage de l’écriture au rôle, de « l’introverti à l’extraverti », et à la chronologie des implications dans ces arts.
Écrivain il aime donc lire ses textes à voix haute. Sa réponse concernant son expérience de lecture mériterait d’être citée intégralement. Noter, au moins, les « mots lancés comme des fléchettes », où il perçoit surtout faire jaillir des « énergies », une transmission palpable, matérielle, semant de quoi faire « essaimer ». Comme si le poème lui échappait, devenait multiple vibration signifiante, se métamorphosait, en passant par le son dans les consciences d’autrui. Le son, donc la musique. C’est logique qu’il travaille aussi avec des musiciens, pour que se « tissent » des « correspondances »
Le cinéma, c’est pour lui, « pouvoir entrer dans des fictions », pénétrer « dans une dimension de jeux ». Alternance entre la démarche solitaire, écriture, et le partage en équipe, cinéma.
Suivent deux poèmes, extraits de Nos cauchemars sont calmes comme des oiseaux endormis, Alidades, 2024.
Le premier texte est troublant, évoquant une « camisole interne », née d’une « peine infinie », qui aurait partagé le corps en deux espaces. Ce serait une sorte de perception de l’archéologie de soi, la structure invisible sue dans la profondeur de la conscience corporelle. D’un moment de souffrance, ou d’un moment de fulgurance de lecture intime. Fiction de soi ou vérité de soi, il faudra lire le recueil pour savoir comment cela advient et devient.
Le deuxième extrait est très différent. Interrogation plus métaphysique, inquiétude existentielle, mais non limitée à l’individuel, collective, d’espèce.
« Nous sommes terriens par inadvertance » / Ou [...] portés par la corolle des fleurs, / ou [...] fakir sur un tapis de braise »
Le corps, encore, mais pour le difficile ancrage à la terre : « les veines de nos jambes plus chargées de grammaire que de sang. »
L’être-langage, qu’est l’humain...
...............
Autre univers, « On croit rêver... ». Les « oniromancies » de Philippe Blondeau et Tristan Felix (pp. 6-15).
En exergue une citation d’Anton Berder :
« Chaque rêve est un laps gagné sur la mort / Une épouvantable facétie qui invente sa mémoire »
Les textes évoquent la mort autant que les voyages du sommeil ou de la rêverie. Leur texte introductif, signé en inversant leurs prénoms, interroge le rapport entre le langage et le rêve, entre le rêve et le réel (lequel crée l’autre ?). Les proses successives font le récit de fantaisies de l’imaginaire et de l’inconscient, rencontrant de manière parfois angoissante ou tragique un possible réel de la mémoire. Rêve qui est une élaboration réinventant la vie, le passé, ou le révélant. Toujours, le corps (blessé, malade, guéri, ou perdu dans un monde d’images) et la mort (croisée, crainte, vaincue ou frontière traversée...).
Les photographies de Tristan Felix traduisent ce flottement incertain entre présence irréelle et absence suggérée, trace inventée et réel capté.
...............
Traduction. Le poète allemand Gerhard Falkner traduit par Joël Vincent (pp. 17-20).
« Poèmes en plein air », du recueil À Grüningen, Alidadès, 2024 (recension par Françoise Favretto, en partie « Critiques »). Textes sur la nature : « forêt », « lumière solaire ». Le monde végétal mais bruissant de vies animales. Cependant, d’un texte à l’autre la description s’efface pour laisser place à un univers de sens : « l’herbe est un système comme la langue », un « texte » à déchiffrer, à penser avec l’aide d’Héraclite. Et de l’herbe, le poème glisse à la dimension de la terre, planète tournant dans le vide de l’espace et l’errance du temps. Une poésie de philosophe méditant.
...........
Traduction, encore, mais cette fois réflexion sur ce que c’est que d’aller d’une langue à l’autre. Expérience de parcours trilingue, entretien avec Sana Darghmouni (qui traduit trois langues : arabe, français, italien), pp. 21-27.
Pour commencer, mon avant-propos, qui a donné le titre : « Traduire. De soi au monde, une subversion ». Au début, des exergues, des auteurs qui sont tous passeurs de langue ou de culture : Édouard Glissant (le penseur du Tout-monde), Jacques Ancet (immense traducteur autant que poète), Jacques Derrida (qui écrit, dans Le monolinguisme de l’autre, livre sur la perte de la langue maternelle dans un contexte colonial : « la traduction est un autre nom de l’impossible »), Fabienne Verdier (voyageuse fabuleuse en calligraphie chinoise), François Cheng (qui nous révèle ce que les mots du chinois veulent vraiment dire, philosophiquement, et ce que ce partage de sens peut signifier pour l’écriture à son sommet). Beaucoup de références aussi dans le corps du texte, produit de nombreuses lectures sur un sujet qui me passionne, pour avoir vécu enfant dans le bain de trois langues. Et pour considérer que penser la traduction fait déchiffrer bien des énigmes sur ce qu’est écrire. Je termine cette réflexion sur le genre particulier qu’est l’entretien, que j’aime autant lire que réaliser.
Le dialogue avec Sana Darghmouni comporte seize temps. Chacune développant son analyse, moi questionnant (MCSJ), elle (SD) répondant (avec son incomparable expérience, ce parcours de traductrice aussi à l’aise pour traduire "à partir de" telle langue ou "vers" cette langue). Nous mettons toutes deux l’accent sur une éthique de la traduction, favorisant la rencontre des cultures, un métissage des références, des univers.
Citations, la question 4 :
MCSJ. Vous traduisez. Or traduire c’est écrire, c’est une co-création d’un texte. La démarche est-elle pour vous une lecture intensifiée, ou une expérience linguistique particulière, ou une sorte de création autonome, comme une transformation alchimique d’une page, même et autre autant. Ou tout cela à la fois ?
SD. C’est en fait tout à la fois. Traduire est une lecture intense et critique, une réécriture du texte lu, son interprétation, sa trahison, moments de tension et de dialogue permanent avec l’auteur. Tout cela produit un texte traduit qui a l’esprit du traducteur. Une traduction vit avec le souffle de son traducteur. Pour moi il s’agit d’un texte nouveau et d’une création autonome.
................
Le thème du numéro : « Briser le plafond de verre », pp. 29-47.
Jean-Paul Gourévitch élabore une réflexion en plusieurs points.
« Introduction à une poétique de la politique : l’exemple du plafond de verre »
Il étudie la métaphore du plafond de verre, la sortant du risque de fossilisation qu’il a nommé, pour lui redonner une dimension poétique qui nourrit l’imaginaire et réinvestit sens et implication dans le réel.
Un texte de Victor Segalen extrait du récit Équipée, voyage en Chine, mémoire, réflexion. Texte magnifique sur la confrontation de soi à l’autre, quand cet autre est un autre temps de soi, identité floue et sue à la fois, et que vient par cela la possibilité de casser l’écran du temps et de la mémoire, de faire « retour » (pas seulement du trajet).
Charles Pennequin, texte-poème en prose, pense la trace et son effacement. Traces qui s’élaborent, traces qui se défont. La langue qui les inscrit leur donne une matérialité, et la poésie les désincruste du langage qui les enferme.
Ouverture avec un poème en vers de Charles Pennequin, « Chère ombre » :
« on se projette / en nombre d’ombres. / on est projeté / dans le viseur. / c’est le viseur / de l’ombre. »
(...)
« on n’est que des / reprises de phrases, / de voix. »
Suivent des poèmes, pour voyager dans cette métaphore diversement. Plusieurs auteurs.
.................
Hors thème, une petite anthologie, textes divers, plusieurs auteurs
(sélection subjective). Citations.
Ainsi, Cyrille Guilbert, « Des dalles » (poème sur le regard) :
« il y a encore l’ampleur du vide / de l’espace à combler / il commence à l’instant / dans la cage de l’instant qui le contient / la terrasse »
Christian Rigault, « En-tête » :
« Là est la neige qui blanchit le paysage. Là est le drap, c’est-à-dire le linceul qui blanchit la neige.. »
(...)
« Et le feu brûle la mer. Et la mer brûle la lande. Et le feu mouillé sur la lande mouille le ciel. Et le ciel mouillé ignifuge la nuit. »
Iren Mihaylova, « Pensées vers une rebelle » :
« J’ai atterri parmi des ombres, le chemin tracé est une tranchée sans issue, / L’avenir se dessine là où manque la consolation. »
..................
Dossier. La poésie corse (pp. 70-83), Paul Dalmas-Alfonsi.
Entretien (questions de Françoise Favretto), et références (Histoire, et actualité). Poésie entre oralité ou chant et écriture.
En partage de langues (corse, français, italien).
..................
Hommage à Daniel Giraud, « passeur de Tao ».
Par Vincent Courtois.
C’est le texte de quelqu’un qui a une connaissance de l’œuvre de Daniel Giraud et de la culture et philosophie chinoise.
Il résume, pour commencer, le livre sur Li Po, Ivre de tao, sa signification essentielle.
« Dans Ivre de tao, l’analyse de Daniel Giraud du poète Li Po est une méthode taoïste d’être au monde : évanouissement du Moi et épanouissement du Soi par les substances, la gouvernance par le non agir [...]. » Horizon de sagesse, l’Éveil, bascule de conscience.
Il explique comment Daniel Giraud est ce passeur de Tao. Comment il donne des clés pour comprendre la philosophie chinoise et le paradoxe de la dualité constitutive de ce qui rend l’unité possible, ou unicité de tout. Pour enlever à la notion de Yin et Yang l’interprétation simpliste qui est faite souvent il rappelle ce que Daniel Giraud sut transmettre et que François Cheng rend abordable, lui aussi (il pose en référence son ouvrage sur la peinture, Vide et plein, le langage pictural chinois ; on pourrait ajouter le recueil, Le livre du vide médian). C’est cette notion du vide (peinture, calligraphie, philosophie), qui est l’élément ternaire qui fait prendre sens au deux du Yin et Yang.
Concept clé, le processus : évolution, alternance, modification.
Livre important aussi, le Yi King, traduit, rappelle-t-il, par Daniel Giraud qui le distinguait des lectures idéologiques, des projections occidentales. Livre qui n’est pas à réduire à l’idée de divination, mais à comprendre comme un moyen d’étudier, dans différentes situations, les aspects mouvants des réalités, « déplacer notre regard ».
..............
Pages des recensions.
Françoise Favretto a fait notamment une présentation élogieuse du recueil de Gerhard Falkner, À Grünigen, traduit par Joël Vincent. Elle note ce qui était déjà perceptible à la lecture des deux poèmes, un auteur « en recherche d’exigence », et elle mentionne certains poèmes qui l’ont interpellée particulièrement.
J’ai recensé un récit de Theombogü, Un végan chez les Pygmées. Conte initiatique et réflexion sur la double culture mais aussi sur les pièges de l’irrationalité.
Parmi les livres présentés par Jean-Pierre Bobillot, des rééditions d’Apollinaire et Artaud.
Marie-Claude San Juan
.....................................
LIEN :
L’Atelier de l’agneau, édition, et revue L’Intranquille : https://atelierdelagneau.com/
............................................
Note © Trames nomades
02:44 Publié dans Recensions.REVUES.poésie.citations.©MC San Juan | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : l’intranquille 27, l’atelier de l’agneau, françoise favretto, poésie, traduction, livres, écriture, création



















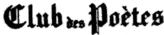




Les commentaires sont fermés.