20/05/2025
À L'Index n°51, revue
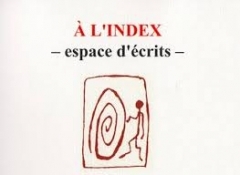 Le dernier numéro d’À L’Index offre, en plus des textes, cinq Encres de l’écrivain et plasticien Hervé Delabarre, respirations entre les pages. On a l’impression de percevoir le mouvement du tracé, et, regardant, on voit des mondes, imagine des visages, silhouettes, espaces.
Le dernier numéro d’À L’Index offre, en plus des textes, cinq Encres de l’écrivain et plasticien Hervé Delabarre, respirations entre les pages. On a l’impression de percevoir le mouvement du tracé, et, regardant, on voit des mondes, imagine des visages, silhouettes, espaces.
L’éditorial de Jean-Claude Tardif pose « une nécessité de Lucidité » (avec majuscule). Que faire du monde et qu’en dire, quand le présent est si inquiétant ? Critique de la pensée du « à quoi bon ? », qui est renoncement et passivité. Inquiétude devant ce que deviennent culture, édition, commerciale, et langage, appauvri. Si, comme il dit le craindre, la poésie ne « suffira pas » à corriger la bascule sombre, il espère cependant qu’elle puisse aider à revenir « aux valeurs d’humanisme qui la fondent et qui nous constituent ». Donc ne pas se taire. Dans ces pages il a mentionné le malaise des choix sémantiques qui recouvrent de fausseté les mots employés : « Nos mots sont de plus en plus des silences ». Et, alors que le numéro n’est pas du tout un volume à thème, les sujets étant libres et divers, j’ai remarqué que le hasard faisait que le silence était évoqué, diversement, par plusieurs auteurs.
Textes, je fais un parcours de certains poèmes, par choix d’axe, pour illustrer le questionnement.
Donc, dans ces écrits il y a de quoi penser les contradictions du rapport au silence. Faut-il y puiser la force de dire, et quel dire alors tracer ? Ou, le relisant, capter et capturer ce qui vient du monde assiéger la conscience ? Démarches opposées, qui peut-être peuvent devenir un choix, une éthique, une évidence qui ne pourra pas accepter un chemin adverse. En parcourant la revue ce sont ces voies étrangères l’une à l’autre qu’on rencontre. Mais il y a aussi les silences qui ont pu être des épreuves.
Dans le visible le silence serait-il le noir ? Dans son titre, « Le noir est aussi une couleur », Richard Roos-Weil le suggère. Et... « Une insulte / Ce choix / Entre l’arbre et le vent ».
Catherine Baptiste, dans son poème « Le silence s’entend », choisit d’écrire « au cœur de ce qui ne se dit pas, pour « voir ce qui n’a pas encore été parlé ». Elle va écouter « bruissements » plutôt que bruits, « frisson » et non choc, « lucioles », pas phare...
Béatrice Pailler, aussi, choisit l’espace du silence, autrement, en installant l’univers de son texte, « La désirée », dans ce qui n’est pas exposé mais suggéré, frôlé. On ne sait pas si on peut entrer dans cet espace, lisant, ses questions dressant des frontières pour protéger ce silence, qui n’est pas nommé, remplacé par « l’attente ». Mais petit à petit c’est dans un tableau qu’on pénètre, avec un oiseau absent, entrevu, perdu, envolé. Une charmeuse officie, qui contemple et dévoile. Le silence est enfin nommé, dernier vers... Mais, avant, il y avait le questionnement.
« Que dire, que faire ? / Agir sans doute, / pour des peut-être /et des possibles / jamais éclos. »
[...]
« Arriverons-nous / au bout de nous-mêmes / en ayant dit et fait ? »
[...]
« À l’avers du silence / au revers du monde / se taire sous l’averse. »
Le contraire du silence c’est la parole quand on s’adresse à quelqu’un, quand on dit nous, quand d’un vers à l’autre on évoque la douceur ou l’exil, le bonheur ou le risque d’une nuit « qui peut sombrer dans l’horreur ». Ce sont les deux poèmes de Noam Weissman, traduits de l’hébreu par Fabienne Bergmann, « Exilés » et « Merci ».
Dans les pages de Jacques Nuñez Teodoro (plusieurs poèmes), il y a des silences qui blessent, des mots qui ont manqué, ou qui n’ont pu sortir de celui qui fut « la bouche pleine de sang / qui s’étouffe de mots », de « Celui qui refuse d’abjurer / son humanité d’Homme ». Le silence, aussi, « a un goût de fer », quand c’est celui d’un lieu où « Tout se tait tout se terre » [...] « Tout se tait tout s’enterre ». Contre cela, contre « ce monde », parler haut : « Je dis très fort qu’il faut le changer ». Des silences en trop, des cris intérieurs, et la solidarité avec ceux qui souffrent, n’ont pas les mots ou le droit de les dire. (Migrants et cadavres en Méditerranée, Femmes afghanes...). Mais le « mystère d’un certain silence fécond », il l’entend dans les poèmes de Jean-Claude Tardif, auquel il consacre un texte, « Juste chuchote ».
Je copie un fragment du poème « Le sang pour levain » :
« J’ai la voix malade le stylo vidé
avec mes ongles plantés aux rainures de paumes incapables
tant je crispe ma colère au creux de mes poings inutiles.
Mes heures sont habitées d’Afriques déboussolées...
Et les pieds de mes immigrés conduisent toujours
à la tombe de mon père. »
Contre le silence, aussi, la poésie ukrainienne de la guerre, traduite par Vladimir Claude Fisera.
De Yarina Tchornohouz, « Si nous survivons tous les deux »
Et de Iya Kiva, « I.XXX » et « II.XXX »
« la guerre revient toujours / comme un cambrioleur ».
De Roberto San Geroteo, dense et fort poème, « Hors-Champs Hors-Saison », silence des pierres ou de la tristesse. Extrait :
« Il y a une sorte de lame de fond
qui corrompt tout jusqu’au bout
des doigts et des branches
c’est de la tristesse
animale végétale
elle rejoint celle des pierres
qui ont toujours leur mot à dire
et le gardent pour elles. »
Jacques Boise est présent avec « Considérations autour de l’effraie ». Contemplation de l’oiseau, la chouette à la tête surprenante qu’il a regardée enfant, suivant son vol, et retrouve, en marcheur, en admirant la beauté. Il se demande ce que ce voisinage lui a « enseigné », et répond « la poésie peut-être, celle de l’air libre ». Et bien sûr il évoque ce qui dans la marche correspond à l’envol de l’effraie : « La marche comme le battement d’ailes sont des recommencements. La solitude qui les meut, fait que l’on s’attache à des riens que l’on porte en soi pour une heure, un jour ou une éternité. Le relatif n’existe pas quand on vole ou chemine. » Plus loin, la marche et la solitude, les angoisses parfois, et l’apparition de l’effraie qui devient une présence, possible signe : « Quand vous êtes seul, la moindre question confine au tragique, côtoie la déroute, celle du corps autant que celle de l’âme. » [...] « Alors quand elle apparaît dans son silence de plumes, immanquablement, on la suit des yeux, l’effraie. Nous guidera-t-elle ? » Cri de l’effraie, et perception d’un accord : « Le silence seul sait ce qui nous est commun ».
De Guy Allix, des extraits de Précaires. « Le premier poème » est sous-titré par des dates (octobre 1971 – juillet 2023). Donc des vers anciens, repris et remaniés des années après. Une écriture qui n’est pas l’illusoire immédiat, une exigence différente. Plusieurs autres textes. Le silence, encore, mais celui qui est en marche en soi, fait partie du destin qui chemine, et la pensée de la mort.
« Ce sera ton pas plus pesant sur l’herbe / Et des mots aux commissures des lèvres qui ne passeront pas / / Ce sera une avancée de plus dans le silence. »
Cependant, « Soudain ce silence seul peut murmurer l’ultime détresse ». et il y a encore à « recueillir » [...] « Cette autre voix perdue qui dirait tout / Et l’enfance même ».
En fin de volume, un dossier sur la poésie congolaise, par André Prodhomme, et une recension de Philippe Simon, lecture d’un recueil de Jean-Claude Touzeil, Cyclitude, Gros Textes.
.........................................................................
Recension © Marie-Claude San Juan, Trames nomades
..............................
À L’Index, revue, et coll. Empreintes, Plaquettes : http://lelivreadire.blogspot.com/
08:18 Publié dans Recensions.REVUES.poésie.citations.©MC San Juan | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : à l’index, revue, jean-claude tardif, littérature, poésie, silence, parole



















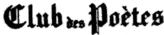




Les commentaires sont fermés.