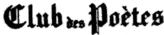Rechercher : michel lamart
Michel Lamart, Carnet d'Eire, Encres vives
 Je commence, avec ce volume, une série de recensions d’Encres vives… Poésie.
Je commence, avec ce volume, une série de recensions d’Encres vives… Poésie.……………………………………………………………………………………
Recension © MC San Juan / Trames nomades
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
LIENS...
Page Michel Lamart. Le Printemps des Poètes… https://www.printempsdespoetes.com/Michel-Lamart
Michel Lamart. Page sur Les Hommes sans Épaules (fiche bibliographique et revues où il est présent)… http://www.leshommessansepaules.com/auteur-Michel_LAMART-...
Encres vives, Michel Cosem... https://encresvives.wixsite.com/michelcosem/edition
Recension Trames nomades. Le Maître de lumière, de Jean-Luc Leguay, enlumineur… http://tramesnomades.hautetfort.com/archive/2019/04/20/le...
Livre de Kells. Fiche wikipedia (et quelques reproductions d’enluminures)… https://fr.wikipedia.org/wiki/Livre_de_Kells
........................................................
Merci pour ce retour, Michel. Courriel suit.
31/07/2021 | Lien permanent | Commentaires (1)
Michel Lamart, Cligner des yeux voir le monde autrement. Photo-poèmes
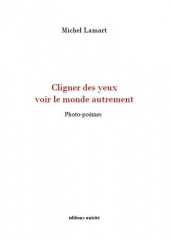 Le livre porte sur la photographie, parcours érudit d’un auteur qui y a beaucoup réfléchi, pensant philosophiquement les questions de l’art (interrogation présente, aussi, peut-on parler d’art ? – mais le livre répond). Le titre montre clairement que le questionnement concerne le regard. En quoi photographier c’est regarder autrement, changer le rapport au regard (peut-être regarder plus, regarder vraiment).
Le livre porte sur la photographie, parcours érudit d’un auteur qui y a beaucoup réfléchi, pensant philosophiquement les questions de l’art (interrogation présente, aussi, peut-on parler d’art ? – mais le livre répond). Le titre montre clairement que le questionnement concerne le regard. En quoi photographier c’est regarder autrement, changer le rapport au regard (peut-être regarder plus, regarder vraiment).
Cligner des yeux voir le monde autrement
Sous-titre, Photo-poèmes
L’introduction, titrée Déjà-vu ? est un texte très dense, qui donne des clés fort utiles pour entrer dans cette méditation de connaisseur, cet essai proposé en poèmes. Que fait donc la photographie, l’appareil photographique, de notre regard ?
Il n’existe aucune photographie de rêve. Voilà un constat, avec cette première phrase, qui dépasse l’évidence. Logique absurde, volontairement inscrite pour introduire une hypothèse qui ferait de la chambre noire, camera obscura, le lieu d’une alchimie capable de transposer, ou de faire émerger, cette réalité onirique que rien ne peut saisir (et qui pourtant existe). Comment, alors, penser la photographie autrement qu’en métaphore, cherchant à déjouer le mystère de la chambre noire ?
Peut-être en la pensant doublement, dans un même geste mental. Philosophiquement en étudiant ce que cela permet de capter peut-être métaphysiquement, dans ce que dit l’image en noir et blanc, par les traces qu’elle révèle, du rapport à la mort, ou, plus, de ce que la réalité de la mort dit à l’être humain, par la photographie - et le temps présent comme sujet permanent de toute photographie.
La mort, le réel, le temps. Trilogie photographique…
(Comment, pour moi, ne pas retrouver un écho avec les pages de Georges Didi-Huberman dans Écorces ? Si la mort est présente, c’est bien là, par les images et par la méditation).
Mais j’ai dit... la pensant doublement. Donc en cherchant aussi chez les penseurs de la photographie ce qui rejoint ou pas son approche, et déplace le questionnement de l’ontologie à l'esthétique (photographie et peinture…).
Cependant il faut ajouter une mention centrale, qui contient philosophie et esthétique, qui est l’intention-racine du livre, et qui lui donne sa forme. Michel Lamart dit vouloir (et il le souligne, après d’autres avant lui – mais sans doute pas de cette manière) suggérer un parallèle entre la photographie et le poème, ajoutant L’un étant l’autre - et vice versa.
Camera obscura… C’est bien plus qu’une réalité technique. La source du processus photographique est mentale autant que technique, nourrissant l’imaginaire de métaphores, comme toute pensée sur l’ombre et la lumière.
L’objet de l’auteur est la photographie argentique, car l’histoire de la photographie naît là et que le sens même en est différent. Il insiste sur le fait que ce n’est pas un goût du passé qui lui fait faire ce choix, mais la nécessité de porter l’étude sur ce qui est au contraire refusé (pense-t-il) dans l’usage de la photographie numérique et ses couleurs. Penser l’effacement (l’argentique l’autorise) et son refus, la mort regardée (le noir argentique l’invite) ou projetée dans l’impensé, écartée, masquée par la couleur.
C’est un point de vue très intéressant (et légitimement argumenté : il faut le lire…), même si on peut le discuter, si on voit dans le numérique une fragilité, finalement, au risque de la disparition, et si la couleur peut parfois signifier symboliquement un autre rapport à la conscience de la mort, autre certes, mais pouvant saisir le tragique comme le fait le peintre ou le cinéaste.
De toute façon on ne peut nier la force visuelle de la photographie argentique, qui ne se réalise que par la maîtrise du génie artisan des grands fondateurs (ou des grands successeurs, car il en est). Puissance de leurs noirs.
Deux parties structurent l’ouvrage.
La première, Photographèmes, explore la question de l’identification de la photographie au poème.
La seconde, Photo-génies, propose un parcours, les portraits des photographes qu’il admire.
Tout cela en poèmes.
Paradoxe que cette énonciation assez théorique, matière d’un essai, en langage de poète ? L’auteur en est conscient. Mais d’une part il l’affirme comme la volonté de dépasser la platitude du siècle nouveau empêtrée dans la « poésie » du quotidien, donnant ainsi une autre dimension à la poésie. Et d’autre part cela est adapté à son sujet, penser poésie et photographie ensemble, et le réel autrement. ll est bon d’en interroger « l’ombre portée », écrit-il, reprenant une expression de Jean-Christophe Bailly.
C’est dire le refus du mensonge que peut être la poésie quand elle n’est pas capable d’interroger l’ombre portée de ce réel alors fantasmé, édulcoré. Et je reprends en plein accord son terme de platitude, car on trouve cela souvent dans des jeux formels qui ne font pas penser. Mentir, la photographie aussi peut le faire. Comme le démontrent en le dénonçant autant Georges Didi-Huberman (Écorces), que Win Wenders (Emotion pictures).
Photographèmes… Trois parties. De la photo. Du photographe. Trait pour trait.
De la photo… D’abord, l’absence, triple. Celui qui regarde une photographie est l’étranger du moment. Le photographe était là, pas lui. Mais autre absence, ce moment, qui n’est plus. Hier ou il y a un siècle, ce n’est plus. Quelque chose / A eu lieu. Et enfin, cet espace saisi n’existe plus, lieu sans lieu.
Triple absence. Peut-être plus.
L’image / Porte le deuil / Du mot
Cependant cette absence, lisant, je la trouve vraie aussi pour la poésie.
Celui qui écrivit n’est plus là, même vivant, même se relisant lui-même.
Celui qui lit n’a plus que les mots, rien du geste d'inscription dans un lieu.
Et la pensée inscrite échappe au temps mobile.
Donc interrogation philosophique pour penser le rapport au réel, pensé en vérité ou pas, sans perte, aussi, de la conscience historique. Il y a un passage très riche où la dimension signifiante de la photographie est appliquée non seulement à l’image mais à soi se pensant comme cette image et son négatif, pas uniquement la trace de son corps sur une photographie mais hors image la conscience présente et l’absence qu’on porte ou qu’on sera.
Dimension analytique, aussi.
Inconscient du cliché
Refoulé photographique
Pulsion de mort
Car la photographie capture l’inconscient, même quand elle cherche à le repousser. Mais elle peut aider à fuir ce qui ne veut pas être vu, du réel et de ses tragédies.
Quand et comment se croisent la photographie et le poème ?
Alchimie du verbe
Chimie de l’image
Du photographe… La question première, pourquoi Le désir de photo ?. Qui en rencontre une autre, car sans photographie il y a cependant le regard.
Que saisit / L’œil du photographe / Quand / Il ne photographie pas ?
Questions, toujours. Que crée le photographe (et crée-t-il ?). Y a-t-il un style ? (Ou pas ?). C’est quoi son talent ? Et que veut-il donc révéler ?
Que croit-il pouvoir révéler que d’autres ne sauraient pas, avec son Don Quichottisme ?
Trait pour trait… Le portrait dit-il le vrai de soi-même ou une fausse apparence ?
Ne serait-ce que le Masque d’un / Masque… ?
Et si on faisait le portrait de la page blanche ? Revoilà l’écriture…
Photo-génies… Pour cette grande partie je vais citer des fragments des poèmes consacrés à quinze grands photographes, maîtres de l’argentique. Un art et des destins… J’ajoute (entre parenthèses) avant les citations, les dates de naissance et de mort, le pays, et un élément qui situe, ou deux, ou plus. Aide à la lecture des poèmes, et ici des citations. En ligne il est possible de voir des photographies de ces grands artistes, souvent pionniers (et en bibliothèque…). Il faudra lire ce livre en aller-retour entre lui et des sites et des livres, enrichir sa connaissance de ces artistes et revenir au texte pour en comprendre mieux le point de vue et les questionnements.
.
Nicéphore Niépce (1765-1833. France. L’inventeur de la photographie, du procédé dit héliographique.)
Au commencement
« La table mise »
Alentour (1822)
Une des premières
Photos
(…)
L’œuvre
Au noir
Du noir
Et blanc
.
Félix Tournachon (1820-1910. France. Connu sous le nom de Nadar. Il est aussi dessinateur et caricaturiste (portrait de Balzac…). A réalisé la première photographie aérienne (d’un ballon dirigeable, et la première photo sous-marine). Portraitiste, a photographié de nombreuses personnalités, dont Baudelaire, Renoir, Sarah Bernhardt. Autoportraits, aussi.)
Pour Tournachon
N’est d’art en photo
Que via la peinture
(…)
Regard intérieur
Que la photo
Révèle
(…)
Dans ce cimetière
De papier glacé
Aux tombes creusées
Au plus profond
De la nuit du Temps
Nous cherchons
Notre propre visage
Sous les traits
De la Mort
.
Émile Zola (1840-1902. France. Connu surtout comme écrivain, et pour sa défense de Dreyfus, son « J’accuse… ! », il est passionné par la photographie et photographie sa vie familiale).
Le sujet
Rien que le sujet
<07/07/2022 | Lien permanent | Commentaires (1)
Ritournelle pour un jardin de pierre, de Michel Lamart (suite d'une lecture esquissée le 19-05-21)
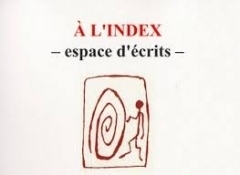 Ritournelle pour un jardin de pierre, de Michel Lamart, À L’Index, coll. Les Plaquettes, 2018.
Ritournelle pour un jardin de pierre, de Michel Lamart, À L’Index, coll. Les Plaquettes, 2018.
Quand j’ai commenté le titre c’était pour rendre compte d’un ouvrage que j’aurais voulu lire (qui était épuisé - et que, depuis, j’ai pu lire). Pour une note sur plusieurs plaquettes, toutes liées au regard. Mais j’avais lu quelques mots sur le site d’À L’Index (Le livre à dire, Jean-Claude Tardif). Et je connaissais suffisamment de textes et travaux de Michel Lamart pour avoir l’intuition de sa démarche et pour deviner que ses mots, accompagnés par des monotypes de Marie Desmée, devaient être un riche exercice de regard. J’avais lu ce qu’il écrivait dans un beau dossier, Autopsier un mirage, consacré à un poète photographe, Michel Mourot, publié par À L’index (n° 38) et recensé ici.
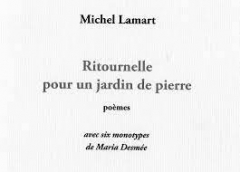 Et le titre, lui, était là, pour faire son office de titre. C’est-à-dire, avant qu’on ait ouvert la moindre page, laisser imaginer ce que pourrait être l’ouvrage (et constater ensuite qu’on a pu se tromper, ou qu’au contraire on a eu l’intuition d’au moins une vérité des textes…). Ritournelle, c’est léger, c’est humble, un petit chant sans importance (qui ne veut pas se donner d’importance), mais c’est aussi ce qui malgré soi tourne dans la tête, avec ses refrains, ses répétitions, le léger devenant parfois triste. Et si la ritournelle est offerte à un "jardin de pierre", plusieurs possibilités (seule la lecture saura…). Je pense aux jardins zen, superbes et dépouillés, espaces de méditation, voulant signifier un détachement qui capte l’éternité. Je pense aussi aux déserts de pierre, juste avant le sable, secs (j’en connais), lieux qu’on peut aimer (adorer) et qui donnent envie d’y rester, où la seule herbe est de cailloux. Jardin de pierre, cela évoque les cimetières, où, sur les tombes, on pose des pierres en hommage. Mais la pierre peut signifier aussi ce qui est dur et froid, les déserts émotionnels, des douleurs qui figent, ou (qui sait ?) des joies qui sidèrent. En tout cas le titre est bon, qui donne à penser, en se trompant peut-être. Ou pas. (Si les significations se cumulent, ce qui est parfois le cas).
Et le titre, lui, était là, pour faire son office de titre. C’est-à-dire, avant qu’on ait ouvert la moindre page, laisser imaginer ce que pourrait être l’ouvrage (et constater ensuite qu’on a pu se tromper, ou qu’au contraire on a eu l’intuition d’au moins une vérité des textes…). Ritournelle, c’est léger, c’est humble, un petit chant sans importance (qui ne veut pas se donner d’importance), mais c’est aussi ce qui malgré soi tourne dans la tête, avec ses refrains, ses répétitions, le léger devenant parfois triste. Et si la ritournelle est offerte à un "jardin de pierre", plusieurs possibilités (seule la lecture saura…). Je pense aux jardins zen, superbes et dépouillés, espaces de méditation, voulant signifier un détachement qui capte l’éternité. Je pense aussi aux déserts de pierre, juste avant le sable, secs (j’en connais), lieux qu’on peut aimer (adorer) et qui donnent envie d’y rester, où la seule herbe est de cailloux. Jardin de pierre, cela évoque les cimetières, où, sur les tombes, on pose des pierres en hommage. Mais la pierre peut signifier aussi ce qui est dur et froid, les déserts émotionnels, des douleurs qui figent, ou (qui sait ?) des joies qui sidèrent. En tout cas le titre est bon, qui donne à penser, en se trompant peut-être. Ou pas. (Si les significations se cumulent, ce qui est parfois le cas).
Puis j’ai pu lire. Et je garde le sens que mon déchiffrement prêtait au titre. Il convient à ma lecture de l’ensemble. Qui suit…
.
En exergue, Jacques Dupin ("rien qu’une image / qui s’enfonce / dans le glacier", Contumace), et une maxime sans auteur (la crainte qu’aurait le Bouddha "face à un poète mineur").
Plusieurs parties, six. Voir en soi, Dans le paysage, Recherche du sommet, Être de pure lumière, Népal, Retour du Népal.
.
Voir en soi
Comme dans son récit de lieu (Eire, Encres vives, note suivante) on retrouve le désir de garder en soi la trace de ce qui est regardé, de l’inscrire en soi, et dans le poème, mais aussi de savoir regarder autrement ces sommets.
"Mais ils ne sont
Pas toi"
En faire un exercice d’acceptation de son étrangeté. L’être minéral ne se mesure qu’à la marche ascensionnelle. Mais le poète cherche à dire la "Minéralité
Du paysage"
avec ce qui serait la "Minéralité
De la langue"
À moins que ce ne soit la langue qui résiste, comme la pierre.
Histoire de voyage, de corps, et d’âme. "Mesure
De l’infini"
Ce qui en rend compte c’est le "blanc", la "neige". `
"Neige métaphysique".
Le voyage des sommets est une expérience de dépouillement de soi, des mots (donc du mental).
.
Dans le paysage
"Tu es
Ce que tu vois"
Une frontière est franchie, là. Comme l’effet de ce vide mental installé, pour n’être que regard.
"Regarder
À travers soi
Ce qui n’est pas soi
Et nous domine"
Savoir de présence au lieu et rien d’autre que cela. Entrer "Dans le paysage".
.
Recherche du sommet
Le sommet enseigne le contraire de la domination. C’est le sens de cette partie. Et il enseigne ce que l’homme n’est pas et ce qu’il est. Valeur de l’humain qui doit partir de l’humain. Le mot "base", ici, fait penser au "pas" de Lao-Tseu ("Le voyage de mille lieues commence par un pas"). Mesure. Le peu pour le plus, sans vouloir le plus. Et conscience de la Nature, qui ne se domine pas.
"La Nature / N’est pas / La mesure / De l’homme
Elle enseigne / À l’homme / Qu’il ne doit pas / À elle / Se mesurer"
.
Être de pure lumière
Et de nouveau l’esprit du Tao (ma perception). Le non-agir de Lao-Tseu. Mais la maxime sur la crainte du Bouddha prend sens aussi, là. Car le Bouddha en soi préfère le silence et le rien immobile. Pour créer le possible de la traversée par l’énergie transformatrice. Donc le poète lâche les mots le temps de sa présence à la fois à lui-même, "Hors / Le chaos / des mots", et sa présence aux sommets de pierre. "J’adhère à la montagne". Comprendre à la fois une adhésion de compréhension de ce que dit la nature à l’homme, et adhésion physique, comme écrit dans les deux premiers vers de cette partie sur la "pure lumière".
"Réconcilier en moi
Biologique et minéral".
Alors savoir "L’universelle continuité
Des êtres et des choses".
Expérience de méditation, tant dans la marche que dans l’assise, dont les traditions savent que l’assis "Involue", écrit-il. Retour à la profondeur sans mots, et démarche du "voir" comme le conçoit Georges Didi-Huberman, il me semble (tel que je le lis).
Feu qui brûle pour un retour à l’essentiel. Mais l’être est
"Brûlé vif
Par sa propre
Parole"
Retournement. Il brûle ce qui le brûle.
.
Népal
Marche nécessaire, et peut-être inutile, se demande-t-il, repensant à la chambre de Pascal…
Si "L’infini
Est en nous".
Mais cette confrontation à un ailleurs, en refusant les pièges des images touristiques, produit une sorte d’intégration d’une identité qui dés-identifie, met hors de sa langue, donne au corps une proximité avec les éléments et paysages. Un devenir hors appartenances. "Je suis le jardin de pierre"… Et le "torrent", le "mur de pierres sèches", le "Yak", le "paysan". Je suis ce que je vois, donc, dit son expérience. Et il évoque autres errants "célestes"… Walt Whitman, Kerouac, Thoreau, Rimbaud, Nietzsche. Habité par le renoncement "à tout", car "tout m’est offert".
"Le rien devient
Tout"
Un espace créé en soi. Ce n’était pas inutile…
.
Retour du Népal
Conscience que celui qui revient n’est pas le même qui partait.
Et que le retour n’est pas séparation totale, le pays quitté demeure en soi. Ce qui a été, départ, "l’arrachement au sol" fait voir en soi un des "cailloux" du "Jardin de Pierre" (jardin métaphore, à la fois, de notre planète et d’un univers intérieur. Qui pourrait être le jardin zen des méditants, que le titre me faisait voir avant même la lecture des pages. Symbole d’une pureté d’être, pas inaccessible, mais à portée de qui se dépouille des charges mentales qui encombrent.
Le poème dit le rêve d’une métamorphose humaine par la rencontre des sagesses d’Orient.
"Voyager / C’est philosopher"
(Oui. Écrire, aussi...)
……………………………………………………………………………………
Recension © MC San Juan / Trames nomades
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
LIENS...
Page Michel Lamart. Le Printemps des Poètes… https://www.printempsdespoetes.com/Michel-Lamart
Michel Lamart, Carnet d’Eire, Encres vives. Recension, MC San Juan/Trames nomades. Note qui suit…http://tramesnomades.hautetfort.com/archive/2021/07/31/mi...
Note antérieure. Les plaquettes, À L'Index... (mise à jour, 30-07-21, avec la suite de cette lecture…) http://tramesnomades.hautetfort.com/archive/2021/05/19/pl...
30/07/2021 | Lien permanent
”Autopsier un mirage”. Dossier Michel Mourot, poète et photographe (À L'Index N° 38)
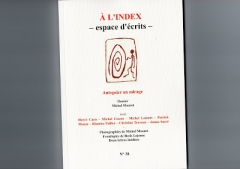 il faudrait au poème un vide
il faudrait au poème un vide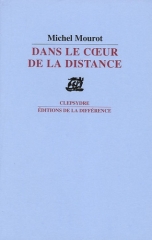 Au centre du paysage, un œil.
Au centre du paysage, un œil. Je rêve parfois d’un poème
Je rêve parfois d’un poème25/06/2019 | Lien permanent | Commentaires (1)
La recension de Michel Diaz pour Le réel est… / DIÉRÈSE, revue de poésie (1er temps de lecture du n° 88…).
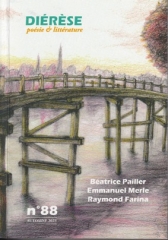 Premier temps de lecture de la revue Diérèse (Daniel Martinez) car (très occupée autrement) j’ai cumulé un retard de plusieurs mois (revues et livres qui s’entassent mais ne seront pas abandonnés…). Et le numéro 89 attend aussi…
Premier temps de lecture de la revue Diérèse (Daniel Martinez) car (très occupée autrement) j’ai cumulé un retard de plusieurs mois (revues et livres qui s’entassent mais ne seront pas abandonnés…). Et le numéro 89 attend aussi…
Dans ce numéro 88 j’ai la joie de lire la superbe, et ample, recension que Michel Diaz a consacré à mon dernier recueil, Le réel est un poème métaphysique (extraits après mon introduction, 2ème partie de la note, suivie du lien vers le site de l’édition). Dans ce numéro je suis en compagnie des lectures qu’il a faites des livres de Jacques Robinet (Clartés du soir, Unicité - recueil que je suis en train de lire...), Richard Rognet (Dans un nid de flammes, L’herbe qui tremble), Jean-Pierre Boulic (Enraciné, La Part Commune). Mais j’ai découvert aussi autre chose. Un texte de Michel Diaz dont je lis surtout les recueils de poèmes et fragments poétiques (écriture que j’apprécie particulièrement et place « haut ») : dans cette revue, pages 199 à 215, un récit troublant, Un petit théâtre de ruines, dont l’exergue (La Rochefoucauld) révèle un sens, un questionnement (frontière indistincte entre vérité et mensonge, ou les fils étranges du destin).
Donc, sa recension. Une capacité intuitive qui lui fait savoir, au-delà des pages à déchiffrer, ce que celle qui écrit tente de décrypter, cet autre savoir dont l’écriture veut dire la souterraine conscience. Il sait, parce que sa démarche d’écrivain se situe dans un espace de profondeur signifiante.
Ce numéro doit être parcouru plusieurs fois, j'y reviendrai. J’y retrouve plusieurs noms connus, et des auteurs à découvrir. De ceux dont je connais l’écriture (en plus de Michel Diaz, dont je viens de recevoir le dernier ouvrage paru, Éloge des eaux murmurantes, créé avec le graveur Lionel Balard) je repère les noms (dans l’ordre des pages où ils apparaissent, pour des poèmes ou des notes de lecture) de Raymond Farina (j’ai fait une recension pour un de ses recueils, dans le numéro 23 de la revue L’Intranquille), Isabelle Lévesque, Béatrice Pailler (que je lis dans la revue À L’index, où nous partageons des pages avec Jean-Pierre Otte, Myette Ronday, et Michel Lamart, notamment, présents aussi dans ce numéro), Emmanuel Merle (nous avons eu un éditeur commun, il y a des années, et je suis attentive aux auteurs croisés ainsi ), Daniel Martinez (poète et éditeur de la revue), Luc-André Sagne (découvert grâce à des groupes littéraires sur Facebook), Jean-Louis Bernard (découvert par ses publications aux éditions Alcyone), Gérard Bocholier (découvert par des notes de lecture révélant un univers qui m’intéresse), Sabine Dewulf (lue aussi sur Facebook, ses thématiques rencontrant des espaces des miennes : lecture programmée d'un recueil récent, Près du surgissement). Mais je relirai aussi, dans ce numéro, l’éditorial d’Alain Fabre-Catalan, Au risque de la poésie, et j'irai découvrir les textes de la rubrique Poésies du monde…
Cependant, là, mon sujet est cette lecture magnifique de Michel Diaz. Je choisis d’en extraire des fragments. Pour en mesurer la valeur sans trahir son art il faut lire son texte intégral, donc dans la revue… mais aussi en ligne sur le site de Michel Diaz, lien en fin de note.
……………………. Extraits :
« "Mes photographies ne veulent rien illustrer. Mes textes ne commentent aucune image", prévient Marie-Claude San Juan dans le texte préliminaire de son recueil, Le réel est un poème métaphysique. Recueil composé de quatre sections, proses réflexivo-méditatives, poèmes, citations, qu’accompagnent 21 belles images photographiques de l’auteure elle-même.
Le sujet du livre est donné dès les premières phrases de l’avant-propos, « Les voiles qui délivrent le caché » : « Éternel ET éphémère, le réel, avec ses traces qui s’effacent, poussière qui glisse entre nos doigts, nous précède et demeurera au-delà de nous, réalité toujours présente quand nous ne serons même plus poussière. Tant que la planète Terre sera planète. »
Mais qu’est-ce que le « réel », cette notion à laquelle la poésie, en première ligne, se trouve confrontée, chargée d’en rendre compte ? Car le « réel » n’est pas le monde, “ la réalité ” telle que notre langue et notre culture avec ses mots, ses préjugés, ses croyances, l’a construite et continue de la modeler en fonction de nos perceptions nouvelles. N’est-ce pas plutôt ce tissu du monde, cette « peau » dont parle Marie-Claude San Juan et qu’elle appelle “ réel ”, qui fonde et déborde notre “réalité ”, la compréhension que nous pouvons avoir de ce qui est ? Ce “ réel ” n’est-ce pas surtout ce après quoi court le poète, mots en avant, comme un qui marche dans la nuit une lanterne à la main ? « Retourner le champ invisible, en écrivant », nous dit-elle. « Parfois tout est immédiat et donné, le palimpseste n’a été effacé et recouvert de signes que souterrainement. » Et elle ajoute : « Mais au-delà de l’instant saisi, cette brutale émergence d’une mémoire des yeux, préférer la permanente lenteur de la gestation de soi. Écrire ? Mettre ses yeux en mots, mais les yeux derrière les mots. »
(…)
« C’est donc cette écriture poétique qu’elle nous donne à lire aujourd’hui avec ce livre, proses et poèmes qui posent l’enjeu du livre (trouver ces « instants où l’immense se rencontre dans l’imperceptible, quand la lumière effleure des parcelles d’or que l’eau invente »), et le lieu même de cet enjeu : le poème comme une ouverture sur l’inconnu. Un petit rectangle de mots qui donne sur ce qu’on ne sait pas...
Ce que nous dit ce livre, c’est qu’il n’y a pas de différence “ ontologique ”, comme disent les philosophes. Qu’il n’y a pas la réalité où nous vivons et une “autre réalité” (le réel) mais que c’est le même monde éprouvé différemment. »
(…)
« "Le hasard peint des couches de marques sur le sol, les portes, les murs, en omniscient caché, créateur de sens. Le temps griffe les surfaces, trace, grave et demeure. Effleurage mystique du toujours non su, caresse du réel calligraphiant notre radicale ignorance." Presque rien, pas grand-chose, voilà ce qui reste quand on se retourne et que les yeux ont regardé. Moins qu’un chemin, moins que des traces, juste un miroitement évaporé. Comme si rien n’avait jamais été. Mais si ce rien qui n’est quand même pas rien, et si ce n’est pas le rien d’en haut dont parlait Simone Weil, ce serait le rien d’ici-bas comme une transcendance qui logerait dans l’immanence, un rien germinatif, quelque chose de l’ordre de ce “ rien qui fait tout surgir ” dont parlait Sören Kierkegaard ? »
(…)
« Ce livre est la démonstration que la quête spirituelle, se passant de toute référence à la transcendance divine, appartient aussi à qui a fait du monde l’objet de son amour et y adhère tout entier pour s’y confondre, ainsi que le disent les derniers mots du texte : « Objectif dénuement / rien ne possède / car rien n’est possédé. Le Je se dépouille même du Je. » Et dans cette démarche de regard que nous propose Marie-Claude San Juan, il n’y a aucune différence entre le sens et la lumière...»
Michel Diaz, 01/10/2022
Lien vers sa recension, site personnel :
https://michel-diaz.com/le-reel-est-un-poeme-metaphysique...
……………………………………...................
Diérèse et Les Deux-Siciles… http://revuepoesie.hautetfort.com
26/02/2024 | Lien permanent
Michel Simonet, balayeur et écrivain.
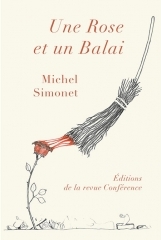
L'article du Nouvel observateur me donne très envie de lire ce livre de Michel Simonet. Après avoir lu avec intérêt l'art poétique de Roger Caillois (son éthique, qui s'adresse quand même plutôt aux auteurs assez connus pour risquer d'en faire usage de pouvoir, il me semble, même si certains points peuvent être adoptés par ceux qui aiment l'ombre - ou que l'ombre choisit...) je trouve que la démarche de cet homme est un art poétique en actes. Il pense la vie en libertaire "total" (total, mais non "radical"). N'ayant pas encore lu le livre je ne peux avoir d'avis sur la qualité littéraire, bien sûr.
Mais j'ai l'impression qu'il y a une profondeur vécue, une sorte de sagesse qui émane de cet homme, un savoir spirituel. Et son goût pour ce métier de balayeur (cantonnier à Fribourg) me fait penser à ce que disait Stephen Jourdain ("sage" s'il en est, pour ne dire par ce mot qu'un peu de lui), dans un de ses livres, revenant sur les tâches quotidiennes qu'il aimait accomplir : balayer, frotter, laver... Sans doute parce que, par ces gestes, on entre ainsi dans un rapport physique à la matérialité du réel, on est dans l'instant pur, loin des idées trop mentales... Donc, je lirai...
L'article de Jérôme Garcin... https://bibliobs.nouvelobs.com/l-humeur-de-jerome-garcin/...
Page de la revue Conférence, 2017 (avec les illustrations, dessins de Pierre Dupont)… http://www.revue-conference.com/index.php
Premier éditeur, diffusion Payot, 2015…. https://www.payot.ch/Detail/une_rose_et_un_balai-michel_s...
12/02/2018 | Lien permanent
Recension. Lignes de crête, de Michel Diaz
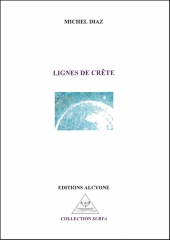 Cette recension était prévue, j’apprécie de la relier à mon parcours de la revue Saraswati, où Michel Diaz est présent (note précédente).
Cette recension était prévue, j’apprécie de la relier à mon parcours de la revue Saraswati, où Michel Diaz est présent (note précédente).Terrible marche que celle de Walter Benjamin, ce chemin sans retour (titre du texte), poursuivi par la police allemande, menacé, sans espoir, qui finit par se suicider le 26 septembre 1940, ne voyant aucune issue.
"s’enfoncer dans sa propre blessure
inverser le regard le tourner
plus profond que soi"
De même, c'est toucher la douleur qu'aborder les années d’Hölderlin proches de la folie, lui qui traça l’injonction superbe qui donne le titre de cette partie, Il faut habiter poétiquement le monde. S’il frôle la nuit de la conscience c’est peut-être pour avoir le courage, en poète, d’interroger le mystère des ténèbres humaines et de tenter les mots qui diront, "seul en sa solitude d’homme et en ses déchirures".
Pour aborder...
"un silence qui vient chercher
dans le remuement de la langue
ce qui livre et délivre
et que la parole ne savait pas
mais qui se disant la dépasse"
Compréhension intime qui fait que Michel Diaz tutoie Hölderlin en ami, en poète sachant ce que l’écriture qui exige rejoint aussi d’ombres douloureuses en soi.
‘tu questionnes ce nœud d’angoisse
où le sort t’a jeté’
Et pourtant, que ce soit pour Walter Benjamin ou Friedrich Hölderlin, derrière le désespoir la présence de ce qui permet quand même d’entrevoir un autre espace.
Malgré la mort qui attend Benjamin, on le sait, le dernier texte est titré "comme on ouvre un chemin", et il évoque "une lumière pacifiée", peut-être pas seulement l’illusion d’un espoir avant la mort qui sera le dernier choix, mais la présence de ce qui "libère l’homme de son ombre".
Et, pour Hölderlin...
"derrière les yeux
ce qui importe est sans visage
et sans regard"
(…)
" - à la fin
une fleur inouïe et pure
s’échappe à la pointe de l’être"
Dans le dernier texte dédié à Hölderlin, mélancholia, c’est Hölderlin qui parle : "je suis né dans le corps d’un ange". Mais ange incarné, et privé, amputé, de ses ailes : "Moi, je boite des omoplates". Comme l’albatros de Baudelaire, dont les ailes traînent sur le pont, et qu’un marin "mime, en boitant". Ailes qui symbolisent l’accès au "monde invisible" évoqué par le préambule. "Je" du poète, si fort qu’il est aussi celui de l’auteur du recueil, mais aussi "Je" de tout poète qui serait digne de l’exigence d’’Hölderlin.
Douleur aussi chez Claude Cahun, dans sa soif de liberté. La folie, elle l’a croisée pendant l’enfance, dans celle de sa mère. Mais c’est la guerre qui l’a affaiblie et qui la fera mourir relativement jeune. L’injustice nommée dans le premier texte c’est l’oubli de l’artiste et poète, retrouvée récemment. L’auteur répare l’oubli…
"Il faudra bien un jour, dis-tu" (…)
"que se lèvent ces mots qu’a semés ta parole."
Et, bien sûr, douleur, pour Alejandra Pizarnik, on le sait, suicidée à 36 ans, à sa troisième tentative. Qui peut savoir la source de son désespoir ? Elle est née en Argentine, mais sa famille était venue d’Europe et parlait encore le yiddish (pour elle il y eut surtout l’amour de l’espagnol de l’écriture, cependant). N’est-ce pas pourtant une clé pour comprendre la souffrance de celle qui parle, dans sa correspondance, de ses "vieilles peurs et terreurs", et écrit, dans un poème "Je m’habille de cendres". Une mémoire trans-générationnelle, la trace de l’exil familial, il y a de quoi nourrir un refus du monde réel. Et de quoi renvoyer en soi à "une zone épouvantable, où il n’y a que peur, peur, peur encore" (Journal). Cercle des peurs nées de l’Histoire, le premier texte dédié à Benjamin rejoint peut-être celui qu’habite Pizarnik.
La dernière innocence, titre du texte dédié, et titre d’un de ses recueils, fragment emprunté à Rimbaud, Mauvais sang, d’Une saison en enfer.
Mais Rimbaud poursuit... "La dernière innocence et la dernière timidité. C’est dit. Ne pas porter au monde mes dégoûts et mes trahisons." C’est donc tout cela qu’Alejandra Pizarnik dit, avec ce titre, et que reprend Michel Diaz pour elle. Lui parlant il dit "tu", mais il dit aussi "nous".
"c’est l’haleine de l’aube
délivrée de son dernier poids
venue d’une douleur ancienne
et des mots qui nous rêvent"
Son écriture, ou une force mystérieuse en elle, malgré tout.
"ce n’est rien qu’une force dressée
contre toutes les nuits à venir"
Mais si, en soi, elle, "nous"…
"il est temps de nous souvenir
qu’en nous veille une inexorable lumière"…
alors il y a toujours la menace de la mort, parce que le ciel est "trace d’une plaie muette"
et les "nuits glaciales" sont
"des nuits chargées de solitude".
Le dernier texte du recueil, présence au monde, est toujours pour Alejandra Pizarnik, elle dont il lui dit que "La mort est une grande malle en sommeil dans la chambre de ton poème". Mais, de ces mots "sidérés" et "sidérant le regard de celui qui les lit", Michel Diaz demande s’ils peuvent "nous consoler". "Et de quoi ?"
Paradoxe, que les mots des chagrins et peurs, des solitudes, puissent être consolateurs ? Ou justement est-ce parce que nous retrouvons en nous les mêmes interrogations et qu’on reçoit un baume en lisant qui a affronté ses ombres (comme le fit Rimbaud dans Une saison en enfer, que lut Alejandra Pizarnik).
Consolés ? De quoi ? Il répond.
"Peut-être de devoir, face au miroir énigmatique, interroger toujours, sans détourner les yeux, la face sombre du destin."
et, ajoute-t-il, "de n’avoir pas su assez retenir’ cet intangible espace où s’inscrit ‘la présence du monde et la mémoire de tout ce qui fut".
Ce dernier texte répond aussi aux autres parties du recueil, il peut être lu comme une conclusion du tout. Consolateurs, aussi, les mots de (et sur) Walter Benjamin, Friedrich Hölderlin et Claude Cahun, comme ceux d'Alejandra Pizarnik. Des ombres, des mots pour les dire. Car ce sont aussi "les mots du jeu du vivre et du mourir". Ce que la poésie peut, et ce qu’elle doit (aider à "habiter poétiquement le monde") ce n’est pas mettre du rêve mensonger et de la joliesse sur la réalité, c’est "sans détourner les yeux" écrire la vie, la mort, le destin, le monde tel qu’il est, les douleurs telles qu’elle sont. Même si c’est "en lettres de sable et de vent", comme le fait le monde lui-même, laideur et beauté, ombre et lumière.
Car, je relis encore ceci…
"il est temps de nous souvenir
qu’en nous veille une inexorable lumière"
Au début de la note précédente, voir aussi ma lecture des poèmes en prose de Michel Diaz (les saisons, Saraswati 16), premières pages de la revue.
J’ai remarqué, dans les coups de cœur de Silvaine Arabo (cette revue Saraswati 16), une recension qui m’intrigue, car elle rejoint un sujet sur lequel j’ai travaillé, pour rendre compte d’un livre de Gabriel Audisio, sur le personnage d’Ulysse (note qui suit). Et que Michel Diaz ait lui aussi consacré un livre à ce mythique méditerranéen m’intéresse particulièrement (je perçois là une porte supplémentaire, essentielle, pour entrer dans sa poésie). Donc, dans Le verger abandonné (éds. Musimot), Michel Diaz fait écrire Ulysse, des lettres pour dire son désir de continuer son errance. Je me demande si l'auteur connaît l’ouvrage de Gabriel Audisio et ce que changera cette lecture (à faire) de ma perception de l’Ulysse d’Audisio. Il me faudra définir le mien… Intéressante confrontation à venir. Mais j’ai trouvé un extrait de la préface de David Le Breton, sur le site de L’Autre livre (association d’éditeurs indépendants, et librairie à deux pas de chez moi…). Dans cette préface je vois des traces qui confortent certaines de mes intuitions (ou hypothèses) au sujet de ce que je pourrai découvrir dans ce livre… Des mots, une citation…
Mais je reprends d’abord un passage de la recension de Silvaine Arabo.
"La probabilité, l’espoir d’être, au fond, sur un chemin qui mène quelque part… Il s’agit bien d’une fête spirituelle dont Ulysse prend peu à peu conscience du fond de ses abîmes… même s’il n’aime pas trop à se l’avouer et s’il lui plaît de voiler son hypothétique 'accomplissement' à venir de 'ténèbres'. Une magnifique écriture, comme toujours chez Michel Diaz."
.........
LIENS
Lignes de crête, Alcyone, page de l’édition. Présentation, préambule, et quelques poèmes… http://www.editionsalcyone.fr/441615234
Site de Michel Diaz… https://michel-diaz.com
Poèmes de Michel Diaz, revue Saraswati 16 sur les saisons. Voir le début de la recension. Note précédente… http://tramesnomades.hautetfort.com/archive/2021/04/16/sa...
Le verger abandonné. Livre de Michel Diaz sur Ulysse (qui choisit l’errance). Extrait de la préface de David Le Breton, site de L’Autre livre, pages de l’édition Musimot… Je relève ce qui rejoint mes questionnements et fait, indirectement, le lien avec les thèmes d’Audisio (note du 27-02-21. Gabriel Audisio, l’ancêtre principal, et Gabriel Audisio, ou Ulysse poète, note suivante, datée du 22-03-21).
‘Mais peu à peu, au fil du cheminement, les contours de son monde intérieur s’effacent, et bientôt il ne reste rien de son identité première ni même de ses raisons d’être, sinon un renoncement progressif, une volonté de faire de son exil une errance perpétuelle au bord du monde dans la tentation de n’être plus personne. ‘Le lieu véritable est-il dans l’absence de tout lieu ? Le lieu, justement, de cette inacceptable absence’, nous dit Edmond Jabès. Telle est l’incise du texte de Michel Diaz de laisser dans l’esprit du lecteur un étonnement, un déséquilibre qui en fait tout le prix.’... https://www.lautrelivre.fr/michel-diaz/le-verger-abandonne
Recension © MC San Juan
Merci à Silvaine Arabo, tant pour la lecture de la recension - j'y suis très sensible - que pour la communication provoquée, tous ces signes...
17/04/2021 | Lien permanent | Commentaires (1)
Sous l’étoile du jour, recueil de Michel Diaz
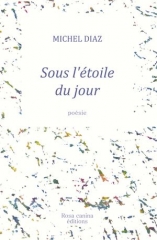 Sous l’étoile du jour, Rosa canina éditions, 2023.
Sous l’étoile du jour, Rosa canina éditions, 2023.
Le préfacier, Alain Freixe, choisit de ne pas faire réellement une préface, si c’est orienter la lecture des textes de Michel Diaz. Il propose « quelques notes prises sur cette partition qu’élabore sa pratique poétique. ». Ces textes, comme en marge, ont, comme exergue, une citation de Jean-Marie Barnaud : « Tu marches cependant / tu ne sais où tu vas / dis-tu / tu vas vers ton secret / telle est l’audace / cela suffit pour une joie. » Choix très judicieux, ces vers, car Michel Diaz aurait pu l’écrire pour lui-même, lui pour qui la marche nourrit la pensée et le geste d’écrire. Et la marche est aussi la représentation d’un processus créatif.
De ces notes je relève un fragment : « C’est toujours la marche en avant. Vers l’impossible salut. À cause de cet appel insensé qui, du fond de notre finitude, nous a fait roi mage de notre vie en quête du vrai lieu. Telle est l’aventure de l’homme cet être des lointains. L’homme dans la poésie de Michel Diaz remonte ses épaules, relève la tête et poursuit. »
Michel Diaz a structuré son recueil en deux parties. Pierre du vent et Sous l’étoile du jour, qui donne donc son titre au livre.
En exergue à la première partie, une citation de Jean-Louis Bernard, dont je copie la première phrase : « La poésie peut ainsi être vue comme un exode sans fin vers le lieu d’où tout procède, vers la parole d’avant les mots. » Loin des définitions faisant d’un pauvre lyrisme un horizon fermé où le poème tourne sur lui-même, absent à ce qui est, la proposition est d’une autre exigence, déplacée dans une dimension où on habite le langage, pour le traverser en le dénudant comme le ferait la philosophie hors systèmes. Ce premier ensemble est le plus court, et ses huit textes n’ont pas de titres, contrairement à ceux qui suivent. Une autre citation, dans le corps de la première page, reprend la pensée de Jacques Dupin sur le « risque absolu » qui doit être celui de l’écriture « sans point d’ancrage » mais pas étrangère à la mort, à ce « volubilis de la mort ».
Pas de titres mais l’espace, le blanc, qui fait de certains mots des îles : ainsi dit-il, ainsi encore, ainsi écrire, ainsi, cela, celle, ce blanc, alors, / et à ce prix, écrire hors. Répétitions : ainsi, écrire, blanc... Dans l’écriture comme pour la lecture s’arrêter sur ces mots qui surnagent, séparés de la prose du poème, pour poser un constat, et se dire à soi-même que c’est cela, écrire, « cette marche qui défie le vide ». Îles, oui, si écrire c’est affronter « le retour inéluctable au même point d’incertitude ». Être en écriture « comme est le naufragé, seul à nager ».
Pierre du vent, associer ces mots dans ce titre rapproche le plus dense, le minéral, au plus léger, insaisissable. Plusieurs sens possibles. Le subtil vent peut être parfois, un mur, dur, contre lequel lutter. Mais quand on écrit il peut figurer le silence des mots, une absence, un vide de sens, comme une pierre fermée. Cependant un texte donne d’autres clés. Le vent serait, gardant sa nature d’élément ondoyant, fuyant, l’image de cette « langue perdue dans les brumes de la mémoire ». Celle qu’on sait hanter l’inconscient d’un langage personnel, fait malgré tout des mots de la langue commune, mais transmués, car écrire franchit la surface des significations apparentes. Il faut extirper d’une profondeur insondable ce qu’à la fois on sait et ne sait pas, « caché au fond de son silence sous sa dalle de pierre ».
Dans le désir d’écrire, il y a celui de cette « parole perdue, peut-être retrouvée ». Peut-être... Incertitude fondatrice car n’annulant pas le « risque absolu » su par Jacques Dupin et Michel Diaz. L’entreprise d’écrire, ainsi, va au-delà de l’intention de créer, qui est aussi une conséquence du voisinage avec le « volubilis de la mort », cette image de l’exergue. La mort est plurielle, présente dans « la nostalgie ardente d’un futur sans promesse », dans l’effacement ou l’émergence du souvenir des « territoires de l’enfance », qui convoque la nature et la beauté mais aussi « douleur » ou « solitude ». Paradoxale, la nostalgie d’un futur qui n’est pas encore. Ou pas, si on entend le regret de ne pas toujours pouvoir ne rien attendre de ce qui sera. Mais nostalgie révélatrice d’un retournement du temps. La mort est un passé, par « la confuse réminiscence du lieu de l’avant-naître ». Avant-naître... Je pense immédiatement à un titre, énigmatique, Le visage d’avant ma naissance, l’autobiographie d’un Anglais, Llewellyn Vaughan-Lee (La Table ronde), initié par une soufie russe, Irina Tweedie, itinéraire changeant son rapport à lui-même, à la notion d’identité, et son rapport au temps. Je pense aussi à Plotin, pour qui l’âme a la nostalgie du lieu d’avant son incarnation, la terre vécue comme un exil (et le titre d’un texte, plus loin, est terre d’exil). Serait-ce le même, pour Michel Diaz, cet « exil dans la présence au monde » ? Ou au contraire un appel « pour vivre plus vivant » ? Ou l’oscillation, peut-être, l’alternance entre deux aspirations, deux blessures qui peuvent aussi cohabiter. Mais cet « avant-naître » est aussi un temps d’avant tout langage, dont l’évocation permet de rejoindre la capacité « d’écrire hors de soi ». Écrire, et « apprendre à désécrire », pour, d’un côté inscrire « ce rien sans nom », de l’autre « donner vie à ce tout qui n’est pas ».
La deuxième partie, la plus ample, Sous l’étoile du jour, a pour exergues les citations de Frank Venaille et Saint-Pol-Roux. Ou le double sens de l’entreprise (marche et écriture) : déchiffrer soi (« me connaître », dit Frank Venaille), déchiffrer le monde, cette « catastrophe tranquille » qu’est l’univers, d’après Saint-Pol-Roux... Possible transfiguration du réel par l’écriture.
Mais cela commence par la parole d’exil, où on peut penser que se mêlent plusieurs déchirures, dans « cet arrachement d’où l’on vient », mais où Plotin n’est pas loin, dans la tension vers un « ailleurs » d’une présence fracturée, tournée vers « la face d’un ciel » qui ne répond pas. L’étoile, qui guide, est « orientée vers l’aire de sa cendre ». Encore la mort, même si c’est le feu venu de la lumière. Et métaphore commencée de ce qui suivra, quatre textes plus loin, évocation de « ceux qui vivent sous la cendre », parmi les souffrants pour qui écrire.
Exil, aussi, que vivre dans « un monde désaxé habillé d’imposture ». Dès le premier texte il y avait la mention d’une avancée « dans le livre de son exil ». Cela revient dans le texte l’homme qui marche. Puis mention de « ceux qui passent » (...) « déjà passés » : éphémères humains. Lui passe, choisit « l’errance » et « les errants ». Mais cette errance trouve une magnificence par le regard porté sur « l’innombrable des visages ».
Il est à l’écoute d’autrui et de qui est rencontré, choses ou gens (« cet inconnu »), et même d’un ange « dans son improbable présence », ou le temps et le monde.
Ce parcours d’errance passe par la douleur des ténèbres du monde, par l’accueil de l’énigme qu’est le vivant, et la magie que le regard saisit de la lumière, de la douceur de l’herbe ou de « la splendeur d’un champ de tournesols ».
L’écriture... Elle advient par la remontée des mots de cette « langue perdue », par l’acceptation d’une « ignorance de tout » comme une sorte d’absolu de non-savoir qui fait revenir à la source de ce qui est à dire : « ce qu’il sait, c’est qu’il ne sait rein, mais qu’il lui faut l’écrire, pour personne, le vent ou les pierres ». Et de la « nudité première » qu’il avait nommée (de « l’air et la peau ») il fait une opération d’effacement pour faire advenir cet « écrire hors », jusqu’à « enfouir son visage et ses yeux dans le sable du temps broyé ». Cette sorte de transe révèle un bord limite de ce que peut être le « risque absolu » d’écrire. Et elle a un témoin, un pareil : l’arbre. Lui aussi sait une « ivresse ascendante ». L’écriture puise « dans le noir interne du front ». Dans les douleurs et tristesses « d’une impartageable consolation » le poème s’écrit « au bord de l’abîme ».
Le silence est aussi celui d’un ciel vide de dieux. Alors ne compte que la « terre des hommes », sur laquelle s’étendre, et « ce qui est là ». Reste le choix de « ne pas se résoudre à ce lent crépuscule qui tombe sur le monde ». Vie et mort s’accordent dans la conscience et le poète est « sentinelle », qui va, semant « quelques signes ». Mais la sentinelle dressée sur le bord d’un chemin, c’est un arbre. Tronc, écorce, racines, feuilles, branches. Poète et arbre « de même chair vivante ». Or on retrouve autrement l’étoile du titre, ce signe d’espoir devant les ténèbres du monde. Par l’arbre. Jacques Tassin, pour ouvrir son livre, Penser comme un arbre, a mis en exergue cette phrase de Saint-Exupéry : « Planté dans la terre par ses racines, planté dans les astres par ses branchages, il est le chemin de l’échange entre les étoiles et nous. ». Intuition forte de Michel Diaz, avec le choix d’un titre qui trouve un prolongement dans des textes où l’arbre est magnifié, d’étoile à étoile. À la fin du recueil, la sentinelle, ce très beau texte qui dit la fusion entre le passant, poète, et l’arbre, porte le même message que l’ouvrage du chercheur écologue. (Qui d’ailleurs cite beaucoup les poètes : Hugo, Verhaeren, Baudelaire, Bonnefoy... et rappelle la pensée de Bachelard : « Vivre comme un arbre ! Quel accroissement ! Quelle profondeur ! Quelle rectitude ! Quelle vérité ! »). Le message commun est de cesser d’oublier les arbres, d’arrêter, dit Michel Diaz, « l’ignorance de l’ingratitude ». Arbre, encore, je n’ai pu que penser à un autre écho. Car en quelque sorte les poèmes transmettent ce qu’on apprend des arbres, si on s’en approche, les regarde, les touche. Et Mario Mercier, dans une approche qui est celle de la culture des chamans, a écrit un ouvrage consacré à l’arbre, L’Enseignement de l’arbre-maître (Albin Michel). Ne pas voir là un obscurantisme irrationnel. Cette culture, Jean Malaurie en témoigna dans ses Mémoires, De la pierre à l’âme (Terre humaine). Ainsi la poésie fait accéder à une connaissance que d’autres saisissent autrement, par la science ou l’initiation. La poésie et la marche, ou la poésie dans et par la marche, si on comprend la démarche de Michel Diaz.
Dans le dernier texte, juste après le poème la sentinelle, un texte titré il se fait tard à l’horloge du monde. Les étoiles, un arbre dans la nuit, un chien qui aboie. Ses aboiements renvoient « vers le lointain » les déchirures du monde évoquées dans le livre, et comme une prière à la nuit, une litanie chantant ce qui n’a pas eu lieu, et les traces « d’une joie humble » (...) « opiniâtrement espérée ». L’arbre résistait, le poète aussi, pour « ne pas se résoudre »... Et il crée, retrouvant les paroles du « secret perdu », dispersées par les vents.
Recension © Marie-Claude San Juan
LIENS :
Page Rosa canina… https://rosacaninaeditions.jimdofree.com/les-auteurs/michel-diaz/
Page, L’autre livre.. https://lautrelivre.fr/p/michel-diaz/
Site personnel... https://michel-diaz.com/
Recension précédente… http://tramesnomades.hautetfort.com/archive/2022/05/24/michel-diaz-quelque-part-la-lumiere-pleut-poesie-alcyone-202-6383596.html
11/08/2024 | Lien permanent
Michel Cosem, Encres vives (Rocamadour, lieu... et Œuvres récentes). Ou ”Écrire sous l'écorce”...
 Deux volumes d’’Encres vives.
Deux volumes d’’Encres vives. On lit avec la trace en soi de phrases relues juste avant. Parcourant les articles sur les livres de Michel Cosem, j’ai eu deux fois des passages des Carnets d'Albert Camus en mémoire, comme en surimpression. Ce lien avec le lieu. Parmi les dix mots préférés de Camus, le monde, la terre. L’importance de cet ancrage dans la contemplation de la nature je le trouve aussi là, tant dans ce qui est dit 'sur' Michel Cosem, son écriture, que dans ce que je lis 'de' lui. Et quand je parcours ce qu’il dit de la demeure en pensant à la mort (ce qui reste après nous des lieux sans nous) j’ai devant les yeux la phrase de Camus qui voit, dans la "douceur" de "certains soirs" être une consolation qui aidera à mourir, sachant, dit Camus, "que de tels soirs reviendront sur la terre après nous". Nous sommes des lecteurs habités par des pages qui nous hantent. Mais cela ne fait pas écran, non, cela aide à comprendre. Ceux dont l’écriture est une méditation sur vivre et mourir, avec la conscience que nous sommes éphémères, s’éclairent les uns les autres.
"Écrire sous l’écorce", donc, ce vers du poème cité par Annie Briet, je le retiens plus qu’un autre, car il me semble traduire une poétique. L’écorce c’est la nature, puisque le réel des arbres. Mais c’est soi, notre peau à gratter en écrivant et ainsi aller au centre.
À travers tous ces textes cités, quels mots garder surtout pour prendre trace de cet univers ?
Je note… Lieu, lieux, terre, mystère, regard, imaginaire, rêve.
Je retiens une intention posée comme sens de l’écriture. Et c’est encore Annie Briet qui cite les phrases d’un entretien. Il dit vouloir "développer une vision du monde", "participer à la richesse intérieure de mes contemporains", définissant "l’acte poétique" comme "résistance : contre la pensée uniforme et pratique". Ainsi aider ce qu’on peut interpréter comme la possible expansion des êtres.
Et je me dis que son entreprise de revue-édition doit avoir la même motivation. Produire en nombre des paroles qui élèvent, en ouvrant la porte aux textes de poètes qui amplifieront cette participation évoquée, vers une "vision du monde" enrichie par le regard des poètes.
J’ai parcouru les différentes recensions regroupées ici, sur des recueils publiés chez divers éditeurs (dont L’Harmattan, Alcyone, Unicité, et Encres vives, aussi).
Je note des titres...
L’encre des jours (Alcyone, 2016)
Les mots de la lune ronde et Écho de braise et de cigale (L’Harmattan, 2017, 2018)
Aile, la messagère (Unicité, 2018)
La bibliographie qui complète le volume va de 2004 à 2018 (date de la publication de ce numéro 480). Elle ne contient donc pas le livre recensé plus bas, Encres vives/2020, et pas plus celui que j’ai découvert sur le site de L’Harmattan, au beau titre, Un sillon pour l’infini, 2021.
J’ai d’abord lu les citations choisies par les chroniqueurs. Puis repéré leurs mots, leurs ressentis.
Ils se rejoignent, insistant sur l’importance du regard et de l’imaginaire (ainsi Chantal Danjou), sur la conscience de la "finitude" (Annie Briet), la captation de ce qu’est la nature (Gilles Lades), la place du lieu, des lieux (Christian Saint Paul et Jean-Baptiste Testefort). L’univers animiste mentionné par Murielle Compère-Demarcy je l’ai perçu fortement en lisant le second volume, les poèmes. Ce qu’évoque peut-être aussi Jacmot en mentionnant l’importance de la personnification, dans les poèmes en prose de L’encre des jours (Alcyone). "Il n’est pas une rivière, une colline, une forêt, une roche, une route, qui ne s’anime aussitôt qu’elle est couchée (apprivoisée ?) sur le papier." Du recueil de 2018 paru chez L’Harmattan (Écho de braise et de cigale), Jacqueline Saint Jean dit autant les parts plus sombres (nostalgie, doutes, ombres) que ce qui s’oppose à la "désespérance" (les "gestes"… "enracinés"). Car il y a, écrit, "le partage des connivences et des éternités". Et, dans le même sens, pour voir confirmé que cette poésie est de profondeur, je lis Jean-Louis Bernard, pour Les mots de la lune ronde. "Michel Cosem désencombre la parole de ses artifices pour offrir au lecteur une capacité d’écoute souvent perdue en ce monde, cette écoute qui permet de percevoir l’illimité." D’autres textes méritent aussi lecture. C’est un parcours assez riche.
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
 La pierre à ciel ouvert
La pierre à ciel ouvert
ou
"des espoirs aux lèvres d’étoiles"
Belles pages, qui invitent à "goûter à l’élixir de la beauté".
Poèmes en prose (mais trois en vers). Deux textes par page, sauf le premier, seul sous le titre intérieur. Et dont la dernière phrase, séparée de ce qui précède, pour être lue avec plus d’attention, révèle une perception de notre rapport au monde, cette fausse séparation qui vient de notre difficulté à vaincre le mental, à entrer en osmose avec le non-humain. Parfois, oui, cependant... Mais "si par hasard"… Oui, il suffit de peu pour casser le lien. Alors "tout est à recommencer".
"On ne maîtrisera jamais la dualité".
Superbe premier poème. Une vision mouvante et immobile à la fois. Comment la pierre des rochers peut prendre l’apparence d’animaux ou êtres fantastiques. À moins que ce soit plus que l’apparence. Comment la pierre peut être habitée par quelque chose qui pourrait être l’esprit des animaux (lézards, tortues, crocodiles). Imaginaire puissant ou intuition des "mystères du monde" que les "fées de la rivière" ont "dans leurs flancs". L’imaginaire a les clés du réel. Et de l’inverse de la dualité… Les rochers figurent aussi comme les pages des "tables de la loi" (lois des textes fondateurs ou "lois de la pierre", ou les deux).
Ce recueil est un manifeste amoureux louant la beauté d’un paysage, Rocamadour et ses environs. Mais c’est aussi la trace d’une tension entre les grandes questions métaphysiques et le rapport concret aux choses qu’on peut regarder et toucher.
D’un côté les sujets à penser...
Le temps, celui de tous les jours et celui qui s’échappe (éternel).
La dualité. Le monde vu où s’affrontent rapace réel et fées rêvées. Rapace duel car son cri menace l’accord fusionnel avec la nature, séparant.
L’imaginaire des religions. Les pierres "inventant d’émouvantes histoires de dieux qui n’ont jamais existé et de madone toujours vierge"…
Le passé, l’Histoire. Tout ce qui défila d’humain et de souffrance dans ces lieux. Et "on traverse l’endormissement du monde et les siècles qui vont avec".
Et, autrement, la présence presque charnelle de la nature. Chemins et chemins, rochers, rochers encore, pierre, cailloux. Herbes, lichen, arbres, pollen, rivières, fleurs, dont le rouge coquelicot qui efface, avec le jaune papillon, tout le gris du monde (poussière et vécus). Le papillon jaune me fait penser au papillon noir de Richard Moss (qui joue un rôle troublant pour lui dans une expérience spirituelle, un accès soudain à la non-dualité, ce papillon étant venu se poser un instant sur son front). Richard Moss raconte cela dans Le papillon noir. Cette évocation que je fais n’est pas là par hasard. Dans ce livre les humains sont peu présents, sauf par l’ombre du passage des pèlerins et la trace de ceux que l’arbre mort aime (l’arbre où un oiseau "affirme à qui veut l’entendre qu’il n’y a pas de désert intérieur"). Des jeunes filles, cependant, se penchent sur le ravin, et témoignent de la beauté.
Pas de bruit. Le silence et quelques chants d’oiseaux (ou "leur immémoriale prière").
Des animaux (oiseaux, donc, rapace déjà rencontré, cigale, corbeaux, abeille, et ce papillon jaune…).
Ce qui est le plus remarquable dans ces denses poèmes, c’est que la nature (végétale, animale) partout a une conscience qui s’exprime. Elle dit, oui, "tous les mystères du monde". Les tiges, sous la rosée sans doute, sont "perlées de rêve et d’illusions". L’eau de la rivière est celle de "l’intelligence". Le coucou apprécie "les voix" qui se dressent "contre les bûchers et pour toutes les libertés". Les champs sont "de lettres nues" et "disent l’avenir", rêvant d’humains (ou peut-être de tous êtres, humains et non-humains) "devenus de petits grains de pollen". (Là c’est à certaines pages de Gabriel Audisio que je pense, poèmes où sa méditation fait pleuvoir des étoiles du cosmos, et nous rêve en traces envolées dans l'espace, les humains laissant la planète continuer sa vie sans l'humain). Le dolmen communique, comme les croix des carrefours (car le poète sait deviner ce langage caché, comme il a su entendre le message de l’oiseau).
Les pierres parlent, et les chênes, quand les oiseaux font des "confidences".
Si j’ai pensé au papillon de Richard Moss c’est que le papillon de Michel Cosem en est très proche. Par la perception du vivant non-humain, par un lien avec ce qui dans le monde pense à sa façon, et qu’une conscience humaine peut saisir. Richard Moss a vécu un bouleversement stupéfiant apporté par un papillon. Michel Cosem témoigne d’une connivence avec ce qui l’entoure qui procède d’une connaissance intérieure du même ordre, intuitivement.
Car… "On aura encore cheminé au pays des mots sur les plus beaux chemins de fulgurance."
Et…
"Tout au bout une chance essentielle attend."
……………………………………………………………………………………
Recension © MC San Juan / Trames nomades
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
LIENS…
Michel Cosem, Le Printemps des Poètes… https://www.printempsdespoetes.com/Michel-Cosem
Bibliographie. Livres chez L’Harmattan… https://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=auteurs...
Page auteur, Alcyone… https://www.editionsalcyone.fr/427376417
Page auteur, Unicité… https://www.editions-unicite.fr/auteurs/COSEM-Michel/aile...
Encres vives, Michel Cosem… https://encresvives.wixsite.com/michelcosem/edition
01/08/2021 | Lien permanent
Quelque part la lumière pleut, de MICHEL DIAZ. Poésie (Alcyone, 2022, collection Surya)
 tu savais que le temps se cachait dans le battement de tes cils, mais ne pouvais que demeurer ainsi, et enclos en toi-même, comme un arbre veillant le silence de ses blessures
tu savais que le temps se cachait dans le battement de tes cils, mais ne pouvais que demeurer ainsi, et enclos en toi-même, comme un arbre veillant le silence de ses blessures
Michel Diaz, Quelque part la lumière pleut, p. 13 (le titre vient d’un poème de Silvaine Arabo)
on n’écrit rien avec le rien, même en lisant dans son miroir ce vide qui s’étonne, ni rien non plus avec ce qui s’épuise à lutter contre l’ombre
Quelque part la lumière pleut, p. 25
mais surtout j’écoute le vent, j’écoute les murs, j’écoute les âmes
Quelque part la lumière pleut, p. 71
Je regarde d’abord l’encre de Silvaine Arabo qui introduit le livre (juste après un texte avant-signe). Je la regarde avec la même liberté intérieure que celle que j’ai devant les affiches déchirées que je cherche dans le métro, en capturant du regard des fragments pour recréer un autre imaginaire que peut-être personne n’aurait vu. Évidemment, là, nulle affiche déchirée, mais une création pensée, structurée, de l’art.
Cependant je sens que je réinvente peut-être l’œuvre (après tout c’est ce que l’œuvre veut aussi, toujours).
Ivresse des vents, est le titre de lâencre. Et voilà , avant dâêtre un lieu du livre de Michel Diaz, ce qui prolonge ma lecture de Capter lâindicible de Silvaine Arabo, livre où lâair et le vent font lâépure du réel. Mais dans ce livre de Michel Diaz, ouvert par cette image, dans les dernières pages surtout, celles de lâespoir, épure par lâair et le vent, aussi. Parenté dâunivers dans lâexigence du regard et de lâécriture. Pas étonnant que ce livre de lâun soit dédié à lâautre. Par la dédicace, par le titre, par un exergue, par la citation finale et bien sûr avec cette encre.
Alors je regarde encore et reviennent deux vers de Silvaine Arabo⦠(Capter l'indicible).
Ultime salut au vent
Et à lâoiseau.
Et des mots de son livre, encore. Jubilation, vertige.
Puis deux autres vers d'elle, même recueilâ¦
Ce grand océan cosmique
Qui nous interpelle sans cesseâ¦
Toujours dans la présence de lâencre qui offre des clés pour lire ensuite au plus juste les pages qui viennent.
Câest cela que je vois dans lâencre, pas étonnée quâelle soit là . Car lâUlysse de Michel Diaz était déjà ce voyageur cosmique, dans lâabîme dâune profondeur, interrogeant le destin, les choix, et la bascule toujours possible vers un renoncement, un néant, ou au contraire lâancrage dâêtre, démarche métaphysique au-delà des temps (Le verger abandonné, recension à lire ici, lien en fin de note).
Dans lâencre, serait-ce Ulysse, ce personnage dont lâombre contemple un gouffre bleu, près dâune sorte de fleur verte géante ? Gouffre de lâinfini, car le bleu est sa couleur. Ombres séparées, deux silhouettes sombres, sur une rive ou un bateau, sous un fragment de ciel mauve et un envol dâoiseaux. La solitude des êtres dans les lieux vidés de vie. Mais ayant lu le livre qui suit, je vois aussi la barque de Charon dressé devant lââme dâun mort et traversant le Styx avec lui. Alors Ulysse est aussi lâauteur écrivant pendant lâhiver du confinement, entendant la litanie quotidienne des morts, et qui évoque les fantômes des êtres perdus, ces inconnus, mais aussi les deuils personnels, ces présences-absences dans une maison. Comment penser nos vies sans penser la mort ? Et comment penser le monde tel quâil est sans penser ce quâil fait de la mort ? Cela est dans lâencre comme je la perçois, assez riche pour porter tout lâunivers des pages de Michel Diaz en même temps que toutes les méditations de Silvaine Arabo.
Je ne peux quâassocier cette encre au logo de la couverture, belle conception de Silvaine Arabo, qui est la marque visuelle de lâédition Alcyone. J'y vois un infini, de la douceur.
Quelque part la lumière pleut. Magnifique titre, cet emprunt à la poésie de Silvaine Arabo. Thématique commune aux deux auteurs, la lumière. Croire quâun sens peut émerger, que lâécriture peut faire advenir et transmettre. Ou que, quelque part, cela sâoffre si on le déchiffre. La lumière câest aussi celle qui sourd du mystère de la camera obscura de nos yeux, au profond du regard, et dans la tension entre écrire et être.
Mais un texte précède lâencre.
La première phrase offre les trois titres des parties du livre.
Dans lâincertain du monde
Sâessayer à vivre plus loin
Travailler à lâoffrande
Partir du constat, dire lâintention, agir pour un possible horizon.
Superbe texte, entre prose poétique et philosophie. Constat lucide concernant lâétat du monde, et élan pour ne pas renoncer, éthique dâune présence agissante, par la conscience dans la création. Dans ce texte je trouve un souffle qui a la force de celui d'Albert Camus dans Noces ou LâÃté. Et justement des refus similaires, la même ardeur vitale pour choisir de FAIRE, et un mot commun, qui vient de la même perception dâune nécessité, résister. Recoudre.
Michel Diaz veut (lui et nous, humains) quâon travaille à recoudre les fêlures de lââme, et, avec ce qui nous reste de raison⦠affronter le crépuscule des désastres à venir. Plutôt que dâaccepter le désespoir (frôlé dans certains textesâ¦) il choisit dâécrire que rien ne sera perdu dans l'éternité du silence, tant que (â¦). Câest donc notre choixâ¦.
Albert Camus, qui parle du malheur du siècle en refusant lui aussi le désespoir, veut quâon sache sauver lâesprit, apaiser lâangoisse infinie des âmes libres. Et il écrit que Nous avons à recoudre ce qui est déchiré, à rendre la justice imaginable dans un monde si évidemment injuste (â¦). (Les Amandiers, dans LâÃté).
Recoudre. Cela signifie quâon part de ce qui est, et quâon fait lien. Câest tisser avec le réel, pas avec des projections mentales. Du concret. Chez les deux auteurs la nature, pour rappeler notre ancrage dans le présent matériel et le voisinage du vivant. Du réel. Camus insiste, au sujet des amandiers de son texte. Ce nâest pas là un symbole. Non, pas un symbole, des arbres vraiment. De même la mer présente dans les deux textes. Pour Albert Camus, câest le vent qui vient dâelle. Pour Michel Diaz câest, dans cette page, celle que va rejoindre une rivière. Lui aussi pourrait insister et rappeler que la nature dont il parle, si présente, nâest pas un symbole. Elle est le vrai chemin pour ses pas de marcheur, lâombre vraie du soir avec ses odeurs et ses sons, lâherbe réelle, des arbres quâon peut toucher, des pierres quâon ramasse (il en posait, raconte-t-il, comptant des jours dans notre hiver confiné).
Ce texte dâavant-signe, qui préfigure la structure et la dynamique du livre entier, sera à lire et relire, pour qui veut saisir la densité de lâensemble. Afin de sâen imprégner et dâen saisir la beauté. Il contient beaucoup, tant la perte que la joie, le temps, le silence, le visage et lâarbre. Et il inscrit une écriture qui nâappartient quâà lâunivers de Michel Diaz, une densité particulière, un rythme qui contient du silence, posé dans les virgules, dans les espaces entre les brefs paragraphes (pour le temps dâune respiration), et dans les mots qui donnent à voir, par touches légères (rose, mésanges, arbreâ¦). Car le regard ne se trouve que dans lâimmobilité du regard, même en marchant.
Chaque partie a ses exergues.
Silvaine Arabo pour la première. Cinq vers de Triptyque. Pour inscrire le même regard que celui de lâavant-signe, un constat, et le souffle portant au-delà des douleurs.
Ensuite câest Léon Bralda, La voix levée (pour un rêve vers un ailleurs autre), et Paul Verlaine, Sagesse (Lâespoir â¦).
Enfin, dernière partie, André Gide, Nouvelles nourritures (le don⦠lâoffrande).
â¦â¦â¦â¦â¦â¦â¦â¦â¦â¦â¦â¦â¦â¦â¦..
Dans lâincertain du monde
On ouvre les pages et sâoffrent encore des paragraphes brefs, sans majuscules ni points, seulement des virgules pour marquer les espaces intérieurs. Ãcriture du marcheur qui dessine un chemin, un long couloir de mots où je vois lâimage du rouleau de Jack Kerouac (Sur la route), comme si lâhorizon dâun voyageur et celui dâun marcheur pouvaient se figurer de la même manière. Mais jâai en mémoire, aussi, de longs parchemins enroulés, portant des textes sacrés conservés dans des monastères lointains. Lâécriture et sa part sacrée, avec ou sans dieux. Lâabsence des majuscules fait couler doucement un fleuve de phrases, sans angles.
La route de Kerouac câest une errance, sacrée à sa façon. Celle de Michel Diaz câest une déambulation, autant intérieure que de pas, un parcours libre avec, comme bagage, le regard, des questions, et, peut-être, carnet et crayon. Les questions, câest justement ce dont lâauteur dit vouloir créer un nÅud coulant qui fera du lecteur inconnu le passager dâun espace de silence de funambule, le réceptacle, en son corps, dâune cicatrice inversée, mémoire dâune brûlure. Ambition, pour lâécriture, dâun pouvoir qui est très loin de la fadeur mièvre. Une conception de ce que doit être la poésie, le contraire dâune jolie distraction. Conception active de la lecture, faite pour des mains tisonnières capables de chercher la lumière dans les traces du feu qui a brûlé les questions (et les réponses ?) par lâécriture. Lâinconnu est aveugle, mais muet aussi. Car pour lire il faut se défaire de son propre regard et de ses propres mots, accepter lâeffraction de pensée par les yeux et les mots dâun autre.
Et effectivement on voit, avec les yeux du poète, traçant un poème-prose, un paysage de feuilles, terre, ciel, et forêt, yeux grands ouverts qui sont les yeux de lââme. On est dans un crépuscule dâombres et étoiles, on entend les voix obscures devinées.
Ãcriture du temps du confinement, où la réalité extérieure reste cependant violemment présente, un monde toujours en guerre contre les vivants et contre la vie elle-même (â¦) peu dâhorizon à cette absurde conjoncture quâest le fait dâêtre né.
Il cite Samuel Beckett (⦠juste avancer) et Michèle Vaucelle (déglutir le monde). Alors il faut écrire, et ce monde le restituer dans le cri. Injonction intérieure, éthique affirmée. Exigence qui croise celle de Jean-Pierre Siméon (La poésie sauvera le monde), quand il définit la poésie comme un acte de conscience aigu en sâappuyant sur Roberto Juarroz, quâil cite (la poésie⦠accélérateur de conscience). Ces deux mentions conviennent à la démarche de Michel Diaz, à la brûlure du poème vrai. Et de même ce que dit encore Jean-Pierre Siméon sur la poésie force dâobjection empêchant de se détourner du réel tel quâil est et tel que le livre la poésie. Câest cette vérité du langage qui ne ment pas que propose ce livre, tout en cheminant vers ce lieu où la lumière pleut.
Au bout du réel il y a la mort, celle que pense le guetteur crépusculaire qui écrit, et qui parle de nos peurs, et des impulsions de survie quâon dresse comme des écrans.
Ce livre ouvre ses pages, et il renvoie à dâautres chants, tristes ou pas. Au-delà de toute mélancolie il ouvre dâautres livres et entre dans un concerto de poèmes. Pas nâimporte lesquels, ceux qui contiennent le feu du duende (Lorcaâ¦). Ainsi, le lisant, jâentends, comme en surimpression, le Chant des âmes retrouvées, poème unique qui clôt le livre de François Cheng, ses récits de Quand reviennent les âmes errantes.
La mort a eu lieu ; la mort nâest plus, écrit François Cheng.
Et Michel Diaz poursuit sa méditation.
Il est celui qui penche son visage sur la mer (et nous aussi, lisant). Il regarde, écoute, accepte dâentendre les cris de peur, de douleur et de guerre, malgré le bruit des tumultes du monde, bruit qui les recouvre, masque. Sachant le silence il se lave et nous lave des bruits. Tension dâécriture, dire et les cris et le silence (celui qui permet dâatteindre le centre de la parole essentielle).
Jâai remarqué des reprises de mots sur une même page, toujours en tête des paragraphes.
Par exemple, tu et peut-être (p.11), deux fois chaque.
Et, page 17, répétition de celui qui penche son visage sur la mer, deux fois.
Prolongé, page 18, par trois paragraphes commençant par je lâeusse aimé (celui quiâ¦).
Ou ce vent, page 28, deux fois. devant, p.31, trois fois.
la nuit, tu marches dans toi-même, p.39, deux fois.
tu vis, tout le long de deux pages plus un paragaphe,p.42-43. Anaphoreâ¦
Je pourrais donner deux ou trois autres exemples. Et le dernier, offrande, p.86.
Lâeffet est rythmique. Ces mots ou bribes de phrases sont comme le battement dâune basse dans une composition musicale, permettant ensuite comme un envol du souffle.
Je relis la page 18 et câest tout son Ulysse que je retrouve, présence du personnage mythique tel que le voit Michel Diaz dans Le verger abandonné. Solitude libre qui assume tout de ses choix. Ulysse nâest pas nommé ici, pas évoqué. Mais son esprit hante cette page, à cause des étoiles, du corps ployé dans le vide, à cause des vagues, et de cet être, seul parmi les hommes (â¦) intraduisible et seul (â¦) unique survivant dâun impossible dire et dâune impensable pensée
Seul comme beaucoup dans ce temps de confinement.
Et sâil y a le matin, les collines, lâherbe, la terre, lâhorizon est vide dâêtresâ¦
Fracture bouleversante, le texte dédié à sa mère. En pleine période dâépidémie et dâenfermement, elle glisse dans lâoubli sans limite. Et il la voit se noyer au fond dâ
24/05/2022 | Lien permanent | Commentaires (2)