07/07/2022
Michel Lamart, Cligner des yeux voir le monde autrement. Photo-poèmes
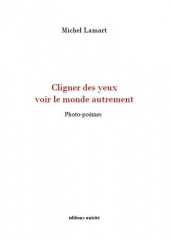 Le livre porte sur la photographie, parcours érudit d’un auteur qui y a beaucoup réfléchi, pensant philosophiquement les questions de l’art (interrogation présente, aussi, peut-on parler d’art ? – mais le livre répond). Le titre montre clairement que le questionnement concerne le regard. En quoi photographier c’est regarder autrement, changer le rapport au regard (peut-être regarder plus, regarder vraiment).
Le livre porte sur la photographie, parcours érudit d’un auteur qui y a beaucoup réfléchi, pensant philosophiquement les questions de l’art (interrogation présente, aussi, peut-on parler d’art ? – mais le livre répond). Le titre montre clairement que le questionnement concerne le regard. En quoi photographier c’est regarder autrement, changer le rapport au regard (peut-être regarder plus, regarder vraiment).
Cligner des yeux voir le monde autrement
Sous-titre, Photo-poèmes
L’introduction, titrée Déjà-vu ? est un texte très dense, qui donne des clés fort utiles pour entrer dans cette méditation de connaisseur, cet essai proposé en poèmes. Que fait donc la photographie, l’appareil photographique, de notre regard ?
Il n’existe aucune photographie de rêve. Voilà un constat, avec cette première phrase, qui dépasse l’évidence. Logique absurde, volontairement inscrite pour introduire une hypothèse qui ferait de la chambre noire, camera obscura, le lieu d’une alchimie capable de transposer, ou de faire émerger, cette réalité onirique que rien ne peut saisir (et qui pourtant existe). Comment, alors, penser la photographie autrement qu’en métaphore, cherchant à déjouer le mystère de la chambre noire ?
Peut-être en la pensant doublement, dans un même geste mental. Philosophiquement en étudiant ce que cela permet de capter peut-être métaphysiquement, dans ce que dit l’image en noir et blanc, par les traces qu’elle révèle, du rapport à la mort, ou, plus, de ce que la réalité de la mort dit à l’être humain, par la photographie - et le temps présent comme sujet permanent de toute photographie.
La mort, le réel, le temps. Trilogie photographique…
(Comment, pour moi, ne pas retrouver un écho avec les pages de Georges Didi-Huberman dans Écorces ? Si la mort est présente, c’est bien là, par les images et par la méditation).
Mais j’ai dit... la pensant doublement. Donc en cherchant aussi chez les penseurs de la photographie ce qui rejoint ou pas son approche, et déplace le questionnement de l’ontologie à l'esthétique (photographie et peinture…).
Cependant il faut ajouter une mention centrale, qui contient philosophie et esthétique, qui est l’intention-racine du livre, et qui lui donne sa forme. Michel Lamart dit vouloir (et il le souligne, après d’autres avant lui – mais sans doute pas de cette manière) suggérer un parallèle entre la photographie et le poème, ajoutant L’un étant l’autre - et vice versa.
Camera obscura… C’est bien plus qu’une réalité technique. La source du processus photographique est mentale autant que technique, nourrissant l’imaginaire de métaphores, comme toute pensée sur l’ombre et la lumière.
L’objet de l’auteur est la photographie argentique, car l’histoire de la photographie naît là et que le sens même en est différent. Il insiste sur le fait que ce n’est pas un goût du passé qui lui fait faire ce choix, mais la nécessité de porter l’étude sur ce qui est au contraire refusé (pense-t-il) dans l’usage de la photographie numérique et ses couleurs. Penser l’effacement (l’argentique l’autorise) et son refus, la mort regardée (le noir argentique l’invite) ou projetée dans l’impensé, écartée, masquée par la couleur.
C’est un point de vue très intéressant (et légitimement argumenté : il faut le lire…), même si on peut le discuter, si on voit dans le numérique une fragilité, finalement, au risque de la disparition, et si la couleur peut parfois signifier symboliquement un autre rapport à la conscience de la mort, autre certes, mais pouvant saisir le tragique comme le fait le peintre ou le cinéaste.
De toute façon on ne peut nier la force visuelle de la photographie argentique, qui ne se réalise que par la maîtrise du génie artisan des grands fondateurs (ou des grands successeurs, car il en est). Puissance de leurs noirs.
Deux parties structurent l’ouvrage.
La première, Photographèmes, explore la question de l’identification de la photographie au poème.
La seconde, Photo-génies, propose un parcours, les portraits des photographes qu’il admire.
Tout cela en poèmes.
Paradoxe que cette énonciation assez théorique, matière d’un essai, en langage de poète ? L’auteur en est conscient. Mais d’une part il l’affirme comme la volonté de dépasser la platitude du siècle nouveau empêtrée dans la « poésie » du quotidien, donnant ainsi une autre dimension à la poésie. Et d’autre part cela est adapté à son sujet, penser poésie et photographie ensemble, et le réel autrement. ll est bon d’en interroger « l’ombre portée », écrit-il, reprenant une expression de Jean-Christophe Bailly.
C’est dire le refus du mensonge que peut être la poésie quand elle n’est pas capable d’interroger l’ombre portée de ce réel alors fantasmé, édulcoré. Et je reprends en plein accord son terme de platitude, car on trouve cela souvent dans des jeux formels qui ne font pas penser. Mentir, la photographie aussi peut le faire. Comme le démontrent en le dénonçant autant Georges Didi-Huberman (Écorces), que Win Wenders (Emotion pictures).
Photographèmes… Trois parties. De la photo. Du photographe. Trait pour trait.
De la photo… D’abord, l’absence, triple. Celui qui regarde une photographie est l’étranger du moment. Le photographe était là, pas lui. Mais autre absence, ce moment, qui n’est plus. Hier ou il y a un siècle, ce n’est plus. Quelque chose / A eu lieu. Et enfin, cet espace saisi n’existe plus, lieu sans lieu.
Triple absence. Peut-être plus.
L’image / Porte le deuil / Du mot
Cependant cette absence, lisant, je la trouve vraie aussi pour la poésie.
Celui qui écrivit n’est plus là, même vivant, même se relisant lui-même.
Celui qui lit n’a plus que les mots, rien du geste d'inscription dans un lieu.
Et la pensée inscrite échappe au temps mobile.
Donc interrogation philosophique pour penser le rapport au réel, pensé en vérité ou pas, sans perte, aussi, de la conscience historique. Il y a un passage très riche où la dimension signifiante de la photographie est appliquée non seulement à l’image mais à soi se pensant comme cette image et son négatif, pas uniquement la trace de son corps sur une photographie mais hors image la conscience présente et l’absence qu’on porte ou qu’on sera.
Dimension analytique, aussi.
Inconscient du cliché
Refoulé photographique
Pulsion de mort
Car la photographie capture l’inconscient, même quand elle cherche à le repousser. Mais elle peut aider à fuir ce qui ne veut pas être vu, du réel et de ses tragédies.
Quand et comment se croisent la photographie et le poème ?
Alchimie du verbe
Chimie de l’image
Du photographe… La question première, pourquoi Le désir de photo ?. Qui en rencontre une autre, car sans photographie il y a cependant le regard.
Que saisit / L’œil du photographe / Quand / Il ne photographie pas ?
Questions, toujours. Que crée le photographe (et crée-t-il ?). Y a-t-il un style ? (Ou pas ?). C’est quoi son talent ? Et que veut-il donc révéler ?
Que croit-il pouvoir révéler que d’autres ne sauraient pas, avec son Don Quichottisme ?
Trait pour trait… Le portrait dit-il le vrai de soi-même ou une fausse apparence ?
Ne serait-ce que le Masque d’un / Masque… ?
Et si on faisait le portrait de la page blanche ? Revoilà l’écriture…
Photo-génies… Pour cette grande partie je vais citer des fragments des poèmes consacrés à quinze grands photographes, maîtres de l’argentique. Un art et des destins… J’ajoute (entre parenthèses) avant les citations, les dates de naissance et de mort, le pays, et un élément qui situe, ou deux, ou plus. Aide à la lecture des poèmes, et ici des citations. En ligne il est possible de voir des photographies de ces grands artistes, souvent pionniers (et en bibliothèque…). Il faudra lire ce livre en aller-retour entre lui et des sites et des livres, enrichir sa connaissance de ces artistes et revenir au texte pour en comprendre mieux le point de vue et les questionnements.
.
Nicéphore Niépce (1765-1833. France. L’inventeur de la photographie, du procédé dit héliographique.)
Au commencement
« La table mise »
Alentour (1822)
Une des premières
Photos
(…)
L’œuvre
Au noir
Du noir
Et blanc
.
Félix Tournachon (1820-1910. France. Connu sous le nom de Nadar. Il est aussi dessinateur et caricaturiste (portrait de Balzac…). A réalisé la première photographie aérienne (d’un ballon dirigeable, et la première photo sous-marine). Portraitiste, a photographié de nombreuses personnalités, dont Baudelaire, Renoir, Sarah Bernhardt. Autoportraits, aussi.)
Pour Tournachon
N’est d’art en photo
Que via la peinture
(…)
Regard intérieur
Que la photo
Révèle
(…)
Dans ce cimetière
De papier glacé
Aux tombes creusées
Au plus profond
De la nuit du Temps
Nous cherchons
Notre propre visage
Sous les traits
De la Mort
.
Émile Zola (1840-1902. France. Connu surtout comme écrivain, et pour sa défense de Dreyfus, son « J’accuse… ! », il est passionné par la photographie et photographie sa vie familiale).
Le sujet
Rien que le sujet
(…)
L’objectif efface
La plume pour
Un livre unique :
« Denise et Jacques,
Histoire vraie »
.
Alfred Stieglitz (1864-1946. États-Unis. Photographe, galeriste, éditeur de revues dédiées à la photographie, promoteur de la photographie américaine et internationale. De lui je retiens la série des nuages, titrée Équivalents, la ville photographiée de sa fenêtre, et le choix des portraits multiples d’une personnalité, pour ne pas enfermer quelqu’un dans un moment de sa personnalité. Son évolution le fait passer du pictorialisme à la conception de la photographie dite pure – refusant toute manipulation ou recadrage qui modifierait la saisie…)
Rien ne le laisse
Indifférent
(…)
Photos où le blanc
Affirme sa supériorité
Sur le noir
Neige et brouillard
(…)
Photographe ?
Philosophe ?
Vérité d’une vision
Arrachée à l’instant
(…)
La chimie de l’art
Révèle le chaos
Du monde
.
Robert Demachy (1859-1936. France. Photographe pictorialiste et théoricien de la photo – livres et articles. Communication avec Alfred Stieglitz.)
Encrer l’épreuve
Au pinceau
Faire disparaître
Le grain photo
De l’image
(…)
Flous
Contours adoucis
Par le rêve
(…)
Il entend faire de la photo
Un art du Noir et Blanc
(…)
Cadrages et mysticisme
Des sujets
.
Eugène Atget (1857-1927. France. Photographie documentaire, photos de Paris.)
Atget ignore le peuple
Ville : unique objet
De son intéressement
(…)
Atget hésite
Son œil cligne :
Photographies artistiques
Ou documents réalistes ?
.
Brassaï (1899-1984. Guyla Halász dit Brassaï – pseudonyme qu’il emprunte à sa ville de naissance. France. D’origine hongroise, né en Roumanie. Il photographie le monde de la nuit parisienne, la haute société, et fait des photos de mode. Photographie et écrit. Théorise une conception du graffiti comme art, une forme de l’art brut.)
Effets de pluie
Et de nuit
Sur la houille
Luisante des rues
(…)
Brassaï piéton de Paris
De Montparnasse
À Montmartre
(…)
Poète de la gare Saint-Lazare
(…)
Il s’efforce
De ne plus regarder
Pour mieux voir
(…)
Brassaï rêve
D’emprisonner la nuit
Dans sa petite boîte noire
( …)
Son clair-obscur
Poème intimiste
Troublant
.
Willy Ronis (1910-2009. France. Parents originaires de l’empire russe, juifs réfugiés. Photographie humaniste. Des difficultés avec certains journaux qui changent le sens de ses clichés ou effacent un personnage, déception et retrait quelques années.)
Poésie de la rue
Offerte à l’objectif
Foule à la Bruegel
Poings levés : juillet 36
(…)
Du fil cassé de la vie
Capter les miracles
(…)
Photographe d’histoires
Porte ouverte sur l’imaginaire
Au risque de faire mentir
Le réel qui défigure
.
Henri Cartier-Bresson (1908-2004. France. Photographie qui cherche à saisir la géométrie parfaite, pensée du nombre d’or, notion importante pour lui. On caractérise sa démarche par les concepts de « l’instant décisif » ou « tir photographique » - pour dire la capture immédiate d’une rencontre, une scène signifiante, une structure inscrite sur un arrière-plan repéré.)
La géométrie l’inspire
Rythme des surfaces
Lignes et valeurs
Priorité à la composition
Règle du nombre d’or
Et cadavre exquis
(…)
Le sujet regardé dissimulé
Accroît le désir de voir
Ce que la photo ne montre pas
(…)
Inégal combat du tireur à l’arc
On ne rivalise avec la Nature
Qu’en décochant
Une dernière flèche
(…)
Ultime oubli de soi
Zen attitude
.
Walker Evans (1903-1975. États-Unis. Refus de l’art enfermé dans les musées, affirme le goût pour le vernaculaire – cf. ce qu'il dit dans ses entretiens - la culture locale, la rue, les gens tels qu’il sont. Photographie humaniste.)
Art vernaculaire
La photo doit
Rendre service
Être populaire
Utile au peuple
(…)
Pour lui collecter
C’est photographier
(…)
L’image saturée de signes
Convoque l’écrit
Trahit des frustrations
Écrivain ou photographe ?
Evans est double :
Il rend lisible l’image
Visibles les mots
(…)
Sommes
Ce que
Voyons
.
Lucy Schwob (Claude Cahun). (1894-1954. Écriture, création plastique, photographie. A subi l’antisémitisme violent au lycée, et été résistante pendant l’occupation).
Travestissement
Du nom
Et du corps
(…)
Écrire contre
Ceux qui lisent
Contre soi
(…)
Se veut
Autre
Résolument
(…)
Elle atteint
L’évidence poétique
Par la photo
.
Laszlo Moholy-Nagy (1895-1946. Né en Hongrie, devenu américain. Peintre, théoricien de la photographie, photographe. Est dit constructiviste, importance donnée à la construction géométrique, art non figuratif).
À l’origine
Photographe
Sans appareil
Théoricien
Du médium
(…)
Écrivain
De la lumière
Il conciliera
Art et technique
(…)
Impalpable
La lumière touche
À la magie
Par son caractère
Spirituel
.
Dora Maar (1907-1997. Henriette Theodora Markovitch, pseudo Dora Maar. France. Peintre et photographe. Proche des surréalistes, muse de Picasso, ce qui effaça sa propre œuvre dans l’esprit du public).
Et la photo
Inventa la femme
Cachée derrière la
Femme
(…)
Voir/non voir
Révélé/caché
Là est tout l’art
De Dora Maar
(…)
Work in progress : Guernica
Elle photographie l’œuvre
(…)
Guernica signe
Un renoncement
Celui de Dora à la photo
(…)
Puis retour à la photo
.
Vivian Maier (1926-2009. États-Unis – mais mère française. Inconnue de son vivant. A travaillé toute sa vie comme gouvernante, nounou. Photographies découvertes très tard et surtout après sa mort. La rue, les gens, des enfants, et des autoportraits.
Son œil en bandoulière
De jour comme de nuit
À l’affût du mystère
Traque le temps qui fuit
(…)
Ne vivant que pour l’art
De rester innommée
(…)
De l’ombre et du reflet
Elle a su faire un style
.
Gérard Rondeau (1953-2016. France. Portraitiste et reporter. André Velter a défini sa photographie ainsi : vécue comme art et comme action. Un site à son nom permet de regarder des photographies, dont beaucoup ont un caractère graphique)
Présence/absence
Qui s’évalue au contraste
Noir sur Blanc cru
(…)
Jouer à cache-cache
Avec soi-même
Avec le réel
Avec le temps
(…)
Le portrait
De l’autre
Est sans doute
Celui du moi masqué
Un autoportrait
Inconscient
(…)
Le flou piège le flou
(…)
Mettre au net
Avec un autre
Regard porté
Sur le monde
………………………………………………………………………………………………………
Recension © Marie-Claude San Juan
........................................................................................
LIENS…
Page Unicité… http://www.editions-unicite.fr/auteurs/LAMART-Michel/clig...
Autres recensions ici …
Recueil, Encres vives… http://tramesnomades.hautetfort.com/apps/search/?s=michel...
Plaquette, À L’Index… Ritournelle pour un jardin de pierre…http://tramesnomades.hautetfort.com/archive/2021/07/30/ri...
19:22 Publié dans Recensions.LIVRES.poésie.citations©MC.San Juan | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : michel lamart, cligner des yeux voir le monde autrement, éditions unicité, unicité, poésie, photographie, regard, art, philosophie
















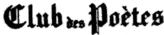




Les commentaires sont fermés.